REGGAE / BASS CULTURE
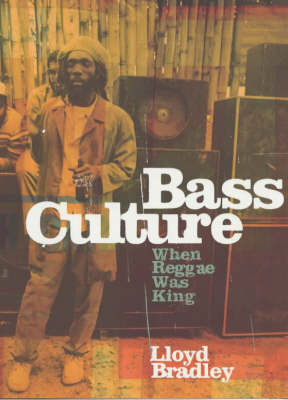
« Bass Culture », est une chanson protestataire de Linton Kwesi Johnson et aussi le titre d’un fort ouvrage sur le genre du journaliste anglais Lloy Bradley (New Musical Express et The Guardian). C’est l’ami Manuel (Rabasse) qui a traduit ce pavé dont je me suis inspiré pour le chapitre sur le Reggae de mon livre en préparation, Les politiques du rock. Le Reggae, un genre très politique justement. Résumé ci-dessous d’un bouquin passionnant. « Enfin, la musique jamaïcaine a le livre qu’elle mérite », comme l’écrit Prince Buster sur la jaquette, celui qui fut l’auteur du célèbre « Al Capone » et l’un des premiers producteurs avec son sound-system et son studio. Yeah mon !
C’est un voyage à travers la Jamaïque et l’Angleterre auquel nous convie l’auteur. Un voyage dans l’espace mais surtout dans le temps.
Il nous décrit d’abord l’île telle qu’elle était dans les années 1950, colonie anglaise dont les terres agricoles sont accaparées par les multinationales américaines pour exploiter les gisements de bauxite et d’aluminium. Une bourgeoisie coloniale règne sur un peuple miséreux qui trouve un peu d’espoir dans les prophéties de Marcus Garvey lequel voit dans le Négus, l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié, un dieu vivant (Jah) et prône le retour des noirs des Antilles dans le pays de la reine de Sabah et du roi Salomon. Les rastas (de Rastafari, le nom de leur culte africaniste) prêcheront inlassablement le retour en Afrique et Garvey, brillant théoricien et activiste de la cause noire, va même engager une souscription pour louer une province du Liberia afin de faciliter ce retour. Il sera inquiété par les autorités coloniales pour fraude fiscale et devra abandonner la partie avant de mourir en Angleterre, en 1940, mais ses mannes vont à jamais hanter l’île.
La situation politique à l’époque voit le règne du PNP (Popular National Party) de Norman Manley, des travaillistes indépendantistes qui militent pour l’indépendance. Une indépendance qui se fera en 1962 avec les rivaux du LJP (Labour Jamaïcan Party, droite libérale) de Hugh Shearer. Les Anglais en ont assez de cette colonie turbulente qui ne rapporte rien et la politique est de laisser le pays entre les mains d’une bourgeoisie compradore locale.
À la fin des années 1950, un genre s’est affirmé, le Ska. Des sound-systems, matériel sophistiqué ambulant pour animer les rues et les parcs, voient le jour en même temps que les studios fleurissent avec des caïds locaux aux manettes. Pour l’heure, on peut citer Duke Reid, un ancien flic de Kingston, Clement « Coxsone » Dodd, Leslie Kong « le Chinois », Edward Seaga (un Syrien qui deviendra ministre du LJP) ou Prince Buster, justement. Il s’agit de rameuter le plus de jeunes possibles avec des singles enregistrés dans les studios des « Big Three » et des groupes locaux se constituent comme les Skatalites ou les Heptones. Beaucoup d’artistes reggae, dont Bob Marley, « Toots » Hibbert et Jimmy Cliff ont commencé très jeunes dans ce style où la rythmique prédomine (on parlera de rhythm’n’blues à l’envers tant le tempo déconcerte) sur des textes qui sont plus des chansons d’amour adolescent que des brûlots politiques. Chaque chose en son temps et, en tout cas, les sound-systems sont les voix du ghetto, là où les animateurs ne se contentent pas de passer des disques, mais commentent l’actualité à grand renfort de blagues salaces et d’esprit frondeur.
Après le Ska vient le Rocksteady, un Ska au ralenti si on peut dire, avec un tempo moins soutenu et des vocaux plus soignés. C’est en 1966 que sortent les premiers singles de rocksteady, les soundmen s’apercevant que les tempos ultra-rapides du ska empêchent les danseurs de souffler. Il fallait bien trouver quelque chose de plus calme et le terme serait venu d’un musicien de studio qui aurait intimé l’ordre à ses collègues de « balancer plus lentement », ce qui fut fait.
En 1967, Prince Buster obtient un hit en Angleterre avec son « Al Capone » et le genre intéresse la jeunesse anglaise. D’abord les derniers mods après le tournant psychédélique de leurs groupes favoris puis les Skinheads, petites frappes pas encore racistes et délinquants (il y aura d’ailleurs des redskins) qui vouent un culte aux parrains du ska comme Laurel Aitken ou Desmond Dekker.
Paradoxalement, ces skinheads accueilleront favorablement leur musique, mais pas les nombreux noirs venus des Caraïbes qui se bousculent aux guichets de l’immigration. De même, les Skins appliqueront souvent les théories racistes de Enoch Powell (l’homme des « rivières de sang ») ou Oswald Mosley pour casser du pakistanais ou de l’indien. La Jamaïque indépendante s’enfonce dans la misère avec une agriculture qui ne suffit même plus à nourrir les insulaires et les rastas adoptent un discours plus social et moins mystique. Ils sont devenus les bêtes noires de la bourgeoisie des planteurs qui voit en eux des malades mentaux.
Le Rocksteady sera déjà un genre passé de mode en 1969 qui sera l’an 01 du reggae. D’autres soundmen, comme Bunny Lee ou Lee Scratch Perry, le plus connu, feront leur apparition en faisant la promotion d’une musique plus pop dont les textes sont souvent des hymnes tiers-mondistes à fort contenu politique et social. Ce sera aussi le temps des effets électro-acoustiques, du dub, overdub, toasing avec U-Roy, Big Youth ou Judge Dread (Mikey Dread animera une émission nocturne sur la radio nationale, Dread at the controls, durant toutes ces années 1970). Ce sera le Reggae.
En 1972, le PNP de Michael Manley (le fils de…) prend le pouvoir, avec l’accent mis sur les réformes sociales : salaire minimum, alphabétisation, aides à l’agriculture et gros budgets mis sur la santé et l’éducation. Tout cela ne sera pas suffisamment et les espoirs du peuple feront long feu.
C’est aussi l’année où sort le film de Perry Henzell The harder they come au festival de Venise, l’histoire d’un pauvre gars de la campagne (joué par Jimmy Cliff) qui arrive à Kingston pour tenter sa chance auprès des producteurs et finit pas sombrer dans la criminalité. La bande-son est une sorte de compilation de ce qui se fait de mieux en matière de reggae avec trois compositions de Jimmy Cliff plus Toots & The Maytals. La même année sort Catch a fire, l’album de Bob Marley et les Wailers qui va les rendre célèbres dans le monde entier.
Les Wailers, c’est bien sûr Bob Marley, le poète, Peter Tosh, le rebelle et Bunny « Wailer » Livingston, le mystique avec, à la rythmique, les frères Barrett. Le groupe récidive avec Burnin’ en 1973 puis Natty Dreads l’année suivante et tous les hits des Wailers sont déjà là («Lively Up Yourself », « I Shot The Sheriff », « No Woman No Cry », « Concrete Jungle », « Kinky Reggae »…). On connaît la suite avec un Bob Marley abandonné par Tosh et Wailer qui accédera au statut de star internationale puis de conscience noire au même titre qu’un Malcolm X, un Mandela ou un Martin Luther King. Tosh et Wailer quitteront le groupe en 1974, et Tosh se rendra célèbre avec son Legalize it, interdit à la Jamaïque après une campagne de Manley contre la culture de la ganja menée en lien avec la DEA, ruinant quantité de paysans. Marley sera à l’origine du concert de la réconciliation entre les deux factions politiques, le 22 avril 1978, le grand événement politique de l’histoire de la Jamaïque, mais ses efforts resteront vains et les revolvers ressortiront.
Les seuls rivaux des Wailers seront les Maytals de Toots Hibbert, auteurs d’un magistral Funky Kingston, leur album de 1973, et de hits comme « Pressure Drop » ou «Sweet And Dandy », les deux titres figurant sur la bande son du film de Penzell. Toots And The Maytals mêlent avec bonheur reggae et soul music et Reggae got soul sera le titre de leur album de 1976.
Une mention spéciale pour Culture et son Two seven clash, un disque exceptionnel, puissant et prophétique. Pour la petite histoire, le 7 juillet 1977 devait être le jour de l’apocalypse dans le calendrier rasta, rapport à la numérologie et au chiffre 7 biblique. On dit que ce jour-là, toute l’île est restée à la maison en tremblant et en priant.
Difficile de parler de la musique de la Jamaïque sans mentionner Chris Blackwell, appelé « le blanc » sur l’île. Un jeune bourgeois anglais grandi à la Jamaïque qui fera connaître tous les trésors musicaux de l’île sous sa marque Island, avant que celle-ci ne se convertisse au rock progressif. Après Blackwell, ce sera Richard Branson et Virgin par l’intermédiaire de son label Front Line qui prendra le relais, Branson s’ingéniant à exporter le Reggae en Afrique, d’abord au Nigeria puis en Afrique du Sud sous apartheid. La vierge était déjà une putain.
On peut parler aussi du reggae anglais, avec des musiciens fils d’immigrés, de la deuxième génération, qui lanceront des groupes dans tout le pays, répliquant les structures – sound-systems et studios – de la Jamaïque. On peut citer Steel Pulse de Birmingham mais aussi le grand Linton Kwesi Johnson, poète et journaliste à ses heures qui va s’illustrer par des textes particulièrement brillants et pleins d’humour. De la critique sociale sur deux ou trois accords.
En Angleterre toujours où la répression policière s’abat sur la communauté jamaïcaine avec d’abord le carnaval de Notting Hill en 1976 qui fera 300 blessés au total des deux côtés, une violence qui culminera avec les émeutes de Brixton en avril 1981. Dès lors, et bien avant, les jeunes jamaïcains auront partie liée avec les Punks et beaucoup de groupes punks (Clash, Elvis Costello, Police, Pretenders ou UB40) emprunteront au reggae. L’alliance entre punks et rastas va culminer dans les concerts Rock Against Racism, à la fin des années 1970. Punky reggae party, comme chantait Bob.
L’auteur conclut à l’affaiblissement du genre après la mort de Marley et divers facteurs cumulés : le numérique, la paranoïa d’un Perry qui brûle son propre studio, la cocaïne qui remplace la ganja, l’américanisation, la gangstérisation du ghetto, la tiers-mondialisation de l’île et les idéaux politiques sacrifiés à la survie. Tout cela et plus…
Voilà. Comment résumer un tel livre sans en trahir le foisonnement , l’érudition et le style, particulièrement enlevé ? Un texte vivant entrecoupé d’interviews. Le mieux serait de vous le procurer. Ah, j’oubliais, le sous-titre du livre est When reggae was king. Quand le Reggae était roi. Le roi des rois ?
Bass Culture – When reggae was ,king – Lloyd Bradley, traduction Manuel Rabasse. Éditions Alia, 2005 (première parution en 2000).
16 janvier 2023
Excellent rappel. Merci Didier pour cette introduction au livre.