NOTES DE LECTURE 56
HUNTER S. THOMPSON – HELL’S ANGELS – Robert Laffont / Pavillon
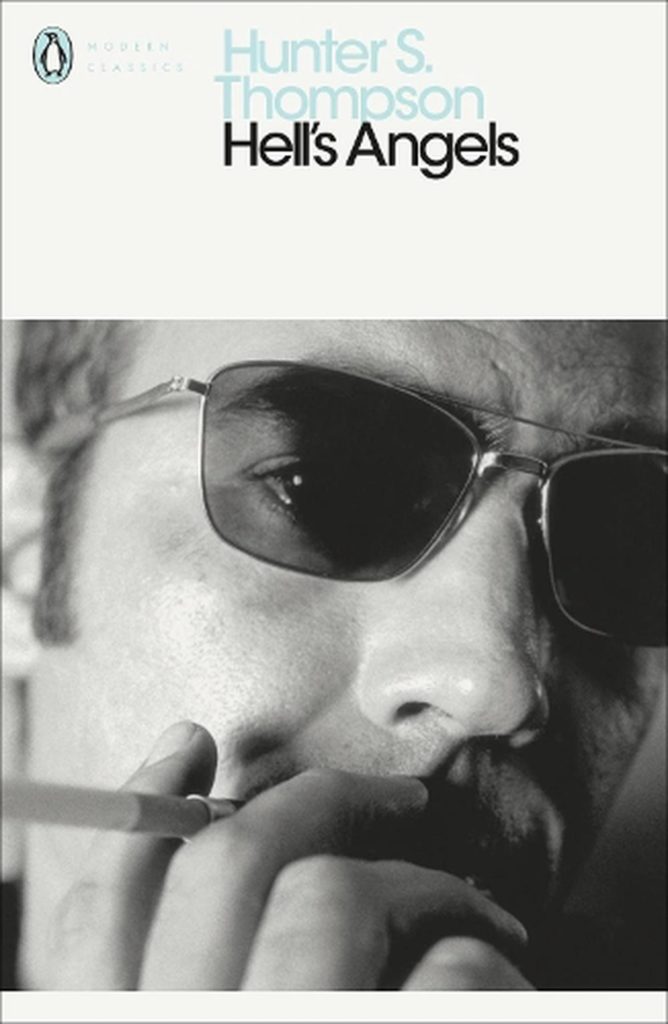
Les lecteurs attentifs de ce blog connaissent bien Raoul Duke, aka Hunter Thompson, inventeur du journalisme Gonzo et politicien occasionnel s’étant présenté comme maire de son patelin du Kentucky.
C’est ici la description ethnologique d’une saison en enfer, chez les Hell’s Angels, de la fin 1964 à la fin 1965. Thompson y va en journaliste, appointé par The Nation, mais son travail relève presque de la sociologie, voire de l’ethnologie . Il commence par décrire la virée du 1° mai 1965 où les Angels du chapitre d’Oakland, avec à leur tête Sonny Barger, leur chef, parcourent la Californie avec leurs Harley trafiquées, leurs gilets sans manche, leurs insignes nazis et leurs casques de l’armée allemande. Une parade qui vise à effrayer le bourgeois et se termine comme toutes les autres avec descente de flics, bagarres et arrestations.
Les premiers Hell’s Angels étaient des anciens marines et G.I de la seconde guerre mondiale, démobilisés et en ayant trop vu pour reprendre le cours d’une vie tranquille. Ils sont, semble dire Thompson, le produit ultime de l’individualisme américain et de l’hédonisme californien. Des marginaux stigmatisés par l’establishment, mais rien de plus. Il faut attendre le rapport du sénateur Lynch les décrivant comme des barbares criminels et surtout le film de Laslo Benecek, The wild one (L’équipée sauvage) avec Brando et Lee Marvin, pour que les Angels, habitués aux ténèbres, prennent la lumière.
Thompson les suit partout pendant un an, de leur quartier général, l’Adobe, un bar d’Oakland, jusqu’à suivre leurs virées dans des bleds reculés de Californie aux fins de terroriser les honnêtes gens et de se frotter avec d’autres bandes (tous les motards marginaux ne sont pas des Hell’s Angels) et aux flics. Thompson garde ses distances, en toute objectivité, ni dans l’apologie ni dans le dénigrement. Il décrit en fin juriste les tracasseries judiciaires et policières que subissent les Angels qui sont le cauchemar de l’Amérique, son surmoi, son « ça ». Ils sont crasseux, laids, bêtes et méchants et ne connaissent que la bière, la bagarre, la baise et accessoirement la drogue (benzédrine, Seconal et Haschisch avant LSD et STP). Ils se bourrent la gueule toute la journée, volent et violent (même si Thompson y va de ses précautions sémantiques, ce sont des viols) dès qu’ils peuvent, et provoquent des affrontements que la plupart du temps ils ne provoquent pas mais que leur seule présence suffit à déclencher. Thompson s’interroge sur un mode de vie marginal en apparence séduisant mais où les protagonistes passent le plus clair de leur temps à s’emmerder en picolant. C’est la raison pour laquelle ils ont un besoin constant d’action, d’aventures, guidés par leur sentiment de toute puissance, leur hubris.
Politiquement, les Hell’s Angels du chapitre d’Oakland n’affichent aucune position, ce qui ne les empêche pas de détester les Noirs et de charger des manifestations pacifistes contre la guerre du Vietnam à Berkeley. Ils disent arborer toute la panoplie nazie pour choquer, mais Thompson fait justement remarquer qu’ils choqueraient plus le bon peuple américain avec des faucilles et des marteaux. En fait, ce sont des libertariens krypto-fascistes qui ne connaissent que la loi du plus fort et détestent toute forme d’intelligence et d’humanité ; même si certains d’entre eux ont le cœur tendre et le sens de l’amitié. Certains ont fraternisé avec les Merry Pranksters de Ken Kesey et ont découvert le LSD, presque convertis au mouvement hippie. Un motif de renvoi. Hilarant de voir un Ginsberg défoncé déclarer sa flamme à Sonny Barger qui n’a jamais rencontré situation aussi embarrassante.
L’affaire se termine mal, et Thompson se retrouve sur le bas côté d’une route avec le crâne défoncé et des côtes brisées, chargé par une bande d’Angels lui reprochant de ne pas vouloir partager l’argent de ses piges. Il est sauvé du pire par un autre ange compatissant mais ne veut plus rien savoir d’eux.
Finalement, les Angels vont se rendre célèbres pour casser du hippie et du gauchiste et leur gestion catastrophique du festival d’Altamont en 1969 (bilan : un mort) les remettront au goût du jour mais sans l’aura d’admiration qu’on aura pu leur témoigner.
Les Angels finiront dans les oubliettes de l’histoire, la plupart – désocialisés et marginalisés – devenus des petits criminels spécialistes du deal et du braquage. Leur place est désormais au Musée de l’homme, entre un spécimen de cannibale papou et un réducteur de tête du Mato Grosso. Thompson, lui inventera le nouveau journalisme dans les colonnes de Rolling Stone où ses reportages au long cours (Las Vegas parano ou La grande chasse aux requins) feront sensation. Hunter (le chasseur selon son pseudonyme) se logera une balle dans la tête en 2005, en écrivain gonzo et journaliste de l’extrême finalement assez proche des Angels, l’esprit, l’humanité et le génie en plus, ce qui change tout.
MICHEL TOURNIER – VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE – Gallimard / Folio
On a déjà parlé ici de Tournier, pas vraiment notre tasse de thé. Romancier académique encensé par la critique unanime en son temps, mais qui vaut plus que son image proprette et lisse. Beaucoup plus.
C’est un étrange roman. Je n’ai pas le souvenir du Robinson Crusoé de Daniel Defoe que j’avais lu dans la Bibliothèque verte il y a longtemps. Peut-être aurais-je dû relire ce livre de l’auteur du Journal de l’année de la peste, un récit terrifiant sur la grande peste de Londres de 1665. C’est ici un Robinson philosophe qui nous est donné à voir, et la post-face de Gilles Deleuze est éclairante à ce sujet.
Crusoé, fils de commerçants quakers de la ville d’York, est le seul survivant du naufrage de La Virginie, un bateau marchand victime d’une collision avec un récif. Il s’échoue sur une île déserte du Pacifique, au large du Chili croit-il, après s’être fait tirer les tarots par Van Deyssel, le capitaine du navire. Crusoé essaie de construire un radeau, L‘évasion, pour reprendre la mer, mais son embarcation est trop lourde et il ne peut l’amener seul à la mer.
Ainsi commence ce récit de l’extrême solitude et de l’absence totale d’autrui, comme le souligne Deleuze. Autrui, l’autre qui est un repère, un répondant, une structure qui rend possible la civilisation et la culture. Faute d’autrui, Crusoé devient ce naufragé solitaire livré à ses névroses, à ses pulsions. Il tient un journal où il écrit les tables de la loi de l’île, son île, mais c’est une illusion. Après avoir voulu organisé le chaos, il se laisse aller à la luxuriance d’une nature pour laquelle il ne compte pas. Peu à peu, Crusoé devient l’île et l’île devient Crusoé. Jusqu’à féconder l’île, ou la terre de l’île, en creusant un trou dans le sol.
Vendredi est un membre de la tribu Araucan qui a échappé au sacrifice par sa tribu. Un métis recueilli par Robinson alors que son intention première était de le tuer. Lui est dans son élément naturel, mangeant des vers, bricolant toutes sortes de pièges, nourrissant des animaux et faisant d’un bouc un corps céleste avant de le transformer en instrument de musique. Il est d’abord l’esclave de l’Anglais, avant de s’en affranchir et de devenir son égal, voire son modèle car Vendredi est adapté ce monde réduit à l’essentiel et il peut en remontrer à Crusoé en terme d’adaptation et de survie à ces conditions de vie élémentaires.
Un bateau arrive finalement à leur portée, mais ni l’un ni l’autre n’éprouvent le désir d’y monter. Surtout pas Crusoé chez qui le ressort de la vie parmi ses pairs, autant dire de la réalité de la civilisation, est cassé ; comme s’il tenait par-dessus tout à cette solitude absolue qui le laisse dans un état d’infinie fragilité mais aussi de démiurge, seul maître à bord dans son monde, au-delà de tout commerce avec ses semblables. Rien que lui-même et sa vie fantasmatique. La folie ?
Comme certains critiques en ont hasardé l’hypothèse, on peut penser que Crusoé est mort lui aussi dans le naufrage, et que ces quelques trente années vécues dans l’île ne seraient que le rêve d’un mort, ou le récit de sa vie après le trépas. Le titre, qui fait référence aux limbes, peut être explicite à ce sujet, limbes d’avant la naissance devenues limbes d’après la mort dans une même étoffe onirique.
C’est le genre de roman riche et inspiré qui laisse la place à toutes sortes d’interprétations mais, tel que se déroule le récit, c’est un livre passionnant qui mêle le récit d’aventure à la quête philosophique, métaphysique.
Tournier avait obtenu le Goncourt pour Le roi des Aulnes, dont on a déjà parlé. Il avait aussi raflé le prix de l’académie française pour ce roman, un jury présidé par Jean D’Ormesson. Amplement mérité et on ne pourra pas dire, à l’instar du Canard Enchaîné après l’admission de D’Ormesson à l’Académie : « un con primé » tant Tournier a toujours mis son style au service d’une intelligence du récit diabolique.
ANDREA CAMILLERI – L’EXCURSION À TINDERI – Fleuve Noir / Presses pocket.
Depuis certaine série sur France 3, les dimanches soirs d’été, on connaît le fringuant commissaire Montalbano et toute sa ménagerie : Nini le play-boy flegmatique, Fazio le besogneux un peu rustre, Livia, l’éternelle fiancée, Ingrid, l’amie suédoise, sans oublier bien sûr Cattarella (dit Cattare), le portier et maître Jacques du commissariat de Vigata qui surprend par ses irruptions incontrôlées dans le bureau de son cher commissaire et par ses pataquès incessants. Une sympathique épique qui fait régner l’ordre sous le soleil de la Sicile, entre terre et mer, et on retient surtout les repas au restaurant du commissaire bougon et parfois taciturne, mais toujours juste et pugnace dans ses enquêtes. Des repas pris sur la terrasse, devant la mer, avec le vin blanc dans le seau et des poulpes en entrée avant des recettes de pâtes aux fruits de mer à damner un saint. C’est la Sicile, c’est plus exactement Vigata.
Disons tout de suite que les romans de Camilleri sont supérieur, et largement, aux adaptations télévisées, bien qu’il y participe. Le bougre sait écrire, il a de l’humour et sait mener une intrigue tambour battant.
C’est ici la découverte du cadavre d’une jeune homme au bas d’un immeuble et la disparition d’un couple de personnes âgées dans le même immeuble. Les recherches de Montalbano le conduisent à cette excursion à Tinderi où le couple de vieux s’était tenu à l’écart des autres passagers. Des photos prises dans le car par une animatrice commerciale identifient une voiture suivant le bus ; cette voiture qui se révélera être celle du jeune homme retrouvé mort.
Une sombre intrigue où le couple de petits vieux était visé en tant qu’héritiers d’une vieille écurie acquise par le jeune homme qui l’utilisait comme centre de communications informatiques pour les mises en contact entre les utilisateurs et les donneurs pour un trafic de greffes supervisé par la mafia, jamais très loin des enquêtes de Montalbano.
Il y a notamment un dialogue entre Montalbano et un ponte local de la mafia tout en sous-entendus et en et en finesse. Le chef mafieux veut en fait faire prendre son petit-fils qu’il juge indigne de la pieuvre, ayant outrepassé les règles de l’organisation.
Un scénario extrêmement bien huilé et, avant de découvrir le pot-aux-roses, on est baladés d’hypothèses en hypothèses et de personnages en personnages, tous plus pittoresques les uns que les autres. Mais ce serait trop long à raconter.
La traduction de Quadruppani est un peu bizarre, voulant restituer le dialecte sicilien et des tournures de phrase de l’île. Ça donne « Montalbano je suis », ou encore « que se passa-t-il? », mais Serge Quadruppani nous éclaire sur ses choix dans la préface. On a le droit de ne pas adhérer.
Sinon, un fichu bouquin,qui se lit presque d’une traite. Sicilia, you’re breakin’ my heart… Air connu.
HONORÉ DE BALZAC – LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE et autres SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE – Gallimard / Folio.
Balzac 002. C’est le deuxième ouvrage de Balzac après son premier roman Les Chouans. Trois longues nouvelles, ou trois courts romans si l’on veut, un volume préfacé par Hubert Juin, grand spécialiste de la littérature du XIX° siècle dont on a pu apprécier l’érudition et le goût très sûr dans ses introductions à des auteurs « fin de siècle », le titre de la collection qu’il dirigeait chez 10/18.
Il est beaucoup question de peintres et de peinture dans ces nouvelles, et Balzac dit s’être inspiré des tableaux de l’école hollandaise. Ses descriptions sont parfois trop longues et on sent chez lui un complexe du peintre qu’il aurait sans doute aimé être. Mais laissons cela et place aux textes.
La maison du chat-qui-pelote est le magasin d’un négociant en draps, de son épouse, de sa fille et de ses commis, considérés comme faisant partie de la famille. Un artiste peintre vient à passer et il reproduit la façade à l’enseigne du chat et la jeune fille qui rêvasse à l’intérieur.
Le peintre s’est épris la belle mais le père veut le marier à sa fille aînée qui s’étiole en future vieille fille. Son commis principal avait forgé le projet d’épouser la cadette mais celle-ci est amoureuse du peintre et c’est lui qui, finalement, emporte le morceau, au grand désespoir de toute la famille.
Dans Le bal de Sceaux, Balzac fait le portrait d’une indécise qui congédie ses prétendants les uns après les autres. Là aussi, elle est en concurrence avec sa sœur pour trouver un mari mais personne ne trouve grâce à ses yeux. C’est en fait le portrait de ce qu’on appellerait aujourd’hui une chieuse, et Balzac décrit les tourments endurés par son père qui va même s’ouvrir de son désarroi à Louis XVIII.
Finalement, la belle Émilie s’amourache d’un peintre – encore un – mais elle recule lorsqu’elle apprend que le jeune homme en question n’est pas noble. La sotte, pleine de préjugés et de morgue, épousera un rejeton d’une vieille famille de la noblesse bretonne qu’elle n’aime pas. Bien fait pour elle !
La Vendetta raconte l’histoire d’un vieux grognard corse de Napoléon qui vient de massacrer toute une famille sur l’île, après l’assassinat de son fils. Une vendetta classique que n’aurait pas reniée Mérimée. Napoléon favorise son retour en grâce. Mais la fille du grognard s’éprend d’un soldat réfugié dans un atelier de peintre après Waterloo et, bien sûr, le brave n’est autre qu’un fils rescapé du massacre dans le maquis corse. Dilemme et situation cornélienne. La fille va répudier ses parents pour aimer librement son soldat, mais l’histoire finit mal, comme si la malédiction poursuivait la famille de génération en génération.
Enfin, La bourse est l’histoire d’un jeune peintre qui fait une chute au pied d’un immeuble où une mère et sa fille l’invitent à se reposer dans leur appartement. Il va sympathiser avec les deux femmes et tomber amoureux de la fille, intrigué par le fait que celles-ci reçoivent des hommes, vieux émigrés retour d’exil, qui dilapident des fortunes au jeu.
Le peintre en vient à se demander si la mère ne prostitue pas sa fille et il croit que la vieille lui a dérobé sa bourse. Ce n’était en fait qu’une heureuse surprise que les deux femmes voulaient lui faire et le peintre finit par vivre dans leur petit monde d’aristocrates ruinés, avec l’amour en prime.
Rien qui ne soit vraiment passionnant dans ces récits de jeunesse, mais c’est Balzac quand même, son style, son art du portrait, sa connaissance de l’âme humaine et de la société de son temps. Car Juin le dit bien dans sa préface, tous ces récits ont lieu entre la période des 100 jours (et du retour de Napoléon) et la deuxième restauration qui voit Louis XVIII revenir de son exil gantois. Balzac est royaliste, mais il admire Napoléon et considère que la révolution française était nécessaire pour corriger les excès de la monarchie. Il est en fait pour une monarchie constitutionnelle libérale, que ce soit dans l’économie et dans les mœurs.
Balzac s’attaquera ensuite à sa Comédie humaine et ses nombreux volumes, mais plusieurs de ses personnages sont déjà présentés dans ces quatre nouvelles. Le portraitiste ironique et délicat, un peu fleur bleue, deviendra ce forçat de la littérature que nous admirons, grâce à des hectolitres de café et à l’amour de Madame Hanska, sa muse. Un peintre féroce de la société de son temps et un moraliste désabusé. Le petit imprimeur ruiné est devenu un génie de la littérature. Votre Honoré du…
13 décembre 2023
Merci Didier pour ces introductions à des ouvrages que je ne connaissais pas.
Quant aux Hells Angels, ma seule expérience avec eux s’est passée au concert des Rolling Stones à Altamont en décembre 1969 – 4 mois seulement après Woodstock, et deux mois et demi après le Big Sur Folk Festival auxquels j’étais aussi présent. A Altamont, je me suis retrouvé à une trentaine de mètres de la ligne de motos qu’ils avaient placées pour empêcher les gens de s’approcher plus près de la scène, et c’est à l’intérieur de cet espace entre leurs motos et la scène qu’ils ont tué leur victime. J’étais poussé de derrière par la foule qui voulait se rapprocher, alors que ceux de devant repoussait la foule afin de ne pas tomber sur les motos. Un vrai cauchemard pendant que Mick Jagger chantait « Sympathy for the Devil » sur scène. Je suis toujours resté aussi loin des Hells Angels que possible par la suite durant les mois suivants du reste de mon séjour à San Francisco.
Je suis surpris que l’éditeur du livre ait laissé passer l’erreur dans le titre de ce livre car le nom officiel du club Hells Angels s’épelle sans apostrophe.