LES PRÉNOMS ONT ÉTÉ CHANGÉS (4) : JÉRÔME.
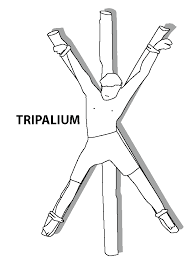
L’enterrement de Jérôme avait eu lieu en l’église Notre Dame des Fleurs, dans la ville de B… La messe avait duré deux bonnes heures, et des proches étaient montés au micro pour dire quel père, quel époux, quel ami ou quel camarade il était , chacun rivalisant dans le panégyrique. Nous nous attardions sur le parvis, Olivier et moi, serrant des mains et échangeant quelques banalités avec des connaissances du syndicat.
Oui c’était brutal. Oui on était loin de s’attendre à ça. Oui c’était quelqu’un de bien. Une belle personne, un type exceptionnel. Ad libitum.
Nous avions souhaité prendre congé assez vite, nous sentant un peu étrangers au cérémonial, au milieu de tous ces visages inconnus, famille, amis et notables de la ville venus pour rendre un dernier hommage à celui qu’ils prenaient pour un des leurs. Mais on nous avait retenus pour un verre au bistrot du coin, Jérôme, avait-on avancé comme argument imparable, aurait été heureux de nous voir tous réunis pour boire un coup à sa santé. Soit, si c’était pour faire honneur à sa mémoire, respecter ses dernières volontés, on ne pouvait pas refuser.
Quelques années auparavant, Jérôme avait été élu au conseil municipal de sa ville et nommé adjoint à l’urbanisme sur une liste rassemblant une large opposition allant des Verts à la droite classique. Il était monté en responsabilité comme en respectabilité, nous faisant parfois perdre le boire et le manger avec ses réalisations et ses projets.
Au syndicat, j’avais souvent rompu des lances avec lui qu’on considérait comme un libéral-libertaire, quelqu’un qui s’enorgueillissait de parler avec tout le monde, cueillant des idées à droite et à gauche (surtout au centre) sans se laisser guider par ces vieilles notions de luttes des classes ou d’histoire du mouvement ouvrier, reléguées en autant de vieilles lunes gauchistes. Dans nos réunions lilloises, nous avions fini par le surnommer Cohn-Bendit, à son insu.
Avec Olivier et Jean-Michel, je dispensais des formations sur ce que le syndicat appelait les risques organisationnels, ex risques psycho-sociaux ou, pour le dire autrement, souffrance au travail. Notre plan était respecté et nos rôles se répartissaient entre les trois parties du cours. Je faisais l’historique des organisations de travail depuis le fordisme et le taylorisme jusqu’aux plus récentes formes d’aliénation issues de la destruction des collectifs du travail avec, en corollaire, l’individualisation des conditions de travail, la pression du client, la solitude et toutes les pathologies du salarié moderne. Jean-Michel prenait la suite avec quelques définitions sur les mots de cette souffrance : stress, harcèlement, burn-out et sur les différentes approches médicales, épidémiologiques, psychologiques ou sociologiques du domaine. Olivier, pour sa part, se chargeait des ripostes syndicales et des mobilisations à mener à travers les instances représentatives du personnel, en plus des ressources théoriques et des moyens juridiques ou médiatiques dont nous disposions. Le tout expédié en deux petites journées avec exercices en ateliers et une large expression sollicitée des stagiaires. Un exercice bien rodé maintenant que nous le pratiquions depuis plusieurs années, assaisonné des citations et pensées fortes des spécialistes de la question, les Déjours, Clot, Davezies, Linhart ou Supiot.
Nous avions fondé une commission du syndicat pompeusement baptisée Observatoire de la Souffrance au Travail (OSAT) sur le modèle de l’observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom. Nous nous réunissions à une dizaine pour publier une newsletter, entretenir un site Internet, organiser des débats publics, des journées spéciales sur le thème des conditions de travail et mettre au point nos formations.
Le midi, nous allions déjeuner à la cafétéria d’un supermarché après un long parcours dans un dédale de rues. Les trois formateurs, un mot qui nous semblait ronflant tant nous doutions souvent de nous et de nos capacités pédagogiques, étaient rejoints par Jérôme qui nous pressait de questions sur notre champ de connaissance. C’est lui qui avait insisté auprès de son syndicat local pour que nos formations, limitées au département du Nord et, plus exactement, à la métropole lilloise, se donnent aussi dans le Pas De Calais et nous n’étions pas peu fiers d’être ainsi sollicités dans des secteurs géographiques où nous n’avions jamais mis les pieds.
Autour d’une grande table sur laquelle se perchait un vidéoprojecteur, une douzaine de stagiaires venus presque exclusivement de trois secteurs professionnels : les télécoms avec un centre d’appel, puisqu’il en existait un dans la ville de B., l’industrie avec une usine de pneus toute proche, et le secteur de la santé avec un hôpital psychiatrique voisin. Tout ce petit monde y allait de son expérience, de ses exemples et de ses anecdotes, avec un besoin de parler et d’exprimer des souffrances qui se révélaient au fil d’explications semblant réveiller leurs mémoires souvent douloureuses.
À la pause, les conversations avec Jérôme reprenaient, lui qui avait les mêmes stagiaires en cours pour une formation CHS / CT. Il soulignait l’importance de nos prestations et citait plusieurs cas de collègues à lui qui avaient été en dépression nerveuse ; l’un d’eux ayant mis fin à ses jours au terme d’un long congé maladie. Pour lui, il fallait en finir avec ce sentiment de toute puissance de directions sûres d’elles, maltraitantes et impunies. Il me décrivait chaque cas particulier en s’attardant avec précision sur le moment où tout avait basculé, une engueulade, un pétage de plomb, une ultime vexation ou une brimade de trop. Des gens solides en apparence, souvent compétents et d’une grande conscience professionnelle, qui soudain abandonnaient et se retiraient du monde, niés dans ce qui les constituait, méprisés dans leur dignité, blessés à mort dans leur fierté. Pourtant combatifs, ils avaient mis le pied à terre et attendaient le coup de grâce, incapables de revenir à un état de santé antérieur maintenant ruiné par la souffrance.
Une semaine jour pour jour après cette formation, c’est Olivier qui m’avait téléphoné pour m’informer de la mort de Jérôme. Assassiné. Il n’avait rien dit de plus, la voix tremblant d’émotion et comme horrifié devant les détails que j’apprenais en allant lire un article de la presse régionale sur Internet. Le meurtre avait eu lieu la veille dans le même bâtiment vétuste où s’était déroulée la formation. Plusieurs coups de couteau donnés par une femme, une maîtresse délaissée si on en croyait les sous-entendus du papier vite torché sous l’angle du sensationnel, ou du sordide. Dans le même bâtiment, sorte de maison communale, où Jérôme tenait ses permanences syndicales, ne le quittant que pour aller porter le fer dans les établissements ou discuter le bout de gras dans les séances de délégués de personnel, de comités d’entreprise ou de CHS. Une sorte d’apostolat qui ne l’empêchait pas de prodiguer ses conseils aux jeunes salariés avec autant d’exemples qu’il puisait dans sa vie professionnelle. Une enquête de police était en cours sur laquelle rien n’avait filtré, nous confiait, à la fin de l’envoi, le localier.
Jérôme était mort dans le lieu même de l’exercice de ses fonctions, même si le meurtre n’avait rien à voir avec celles-ci. Un crime passionnel, avait écrit le journal, ce qui vaudrait des circonstances atténuantes à la meurtrière, supputait-il.
Souffrance au travail, souffrance tout court, tout se confondait dans mon esprit et j’avais en tête l’image du tableau de David, La mort de Marat ou Marat assassiné. Je ne pouvais m’empêcher de relier ce triste fait divers aux deux jours de formation que nous avions vécus ensemble. Comme si la souffrance au travail avait débordé de son cadre pour aller s’inscrire dans l’horreur d’une souffrance totale, de la violence et du crime. Comme une rivière qui aurait quitté son lit pour dévaster toute une région. Et nos notions théoriques de la souffrance prenaient soudain une dimension irréelle, exacerbée comme dans un cauchemar, déformée comme dans une expérience hallucinogène.
Si la souffrance avait un sens pour certains, je la considérais personnellement comme l’ennemie principale à combattre, un combat perdu d’avance, mais que je menais à travers tous mes engagements, avec toute mon énergie. La souffrance durera toujours, me disais-je, comme pour relier artificiellement nos formations à ce fait divers horrible, comme pour tenter de donner un sens à ce qui prenait sa source dans le ça du subconscient ou dans les ténèbres du mal, selon ses convictions et sa conception du monde.
La tristesse durera toujours, écrivait Vincent Van Gogh à son frère Théo dans sa dernière lettre. Ses derniers mots avant son suicide présumé. La mienne, de tristesse, était empreinte de confusion et elle dura le temps de se voir remplacée par l’action collective et les satisfactions personnelles. Au bout d’un certain temps. Une certaine légèreté indispensable à la survie avait surpassé le drame, et je ne gardais de la tragédie que cette phrase lancinante d’une chanson créée par Bo Diddley et chantée par les Pretty Things, mon groupe favori : « bring it to Jerome, bring it on home », avec ses chorus d’harmonica saturés d’une joie insolente.
Super, c’est tellement bien raconté qu’on pourrait croire que ça a vraiment existé ! mais ça fout le blues …
salut Jean-Jacques
J’avais besoin d’écrire cette histoire-là, même si, comme tu le dis, c’est sinistre