MARCUS IMPERATOR
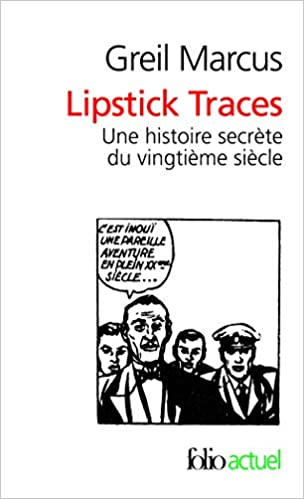
Après Lester Bangs, un article sur le grand Greil Marcus et on aura rendu hommage aux plus grands critiques rock anglo-saxons. Même si on aurait pu y ajouter Richard Meltzer, Lenny Kaye, Peter Toshes (dont on a déjà parlé ici) ; plus les Anglais Nick Kent ou Mick Farren. Marcus est beaucoup plus qu’un rock critique : un écrivain, un sociologue, un politiste, un philosophe et un historien. On lui doit des essais édifiants sur le Punk-rock ou l’histoire parallèle – souterraine – des États-Unis. On lui doit aussi de splendides biographies de Dylan, du Band, d’Elvis Presley ou de Sly Stone. Autant de livres qui vont bien au-delà de la musique, coudoyant le mysticisme et la métaphysique. Marcus, le Roland Barthes américain ?
Greil Marcus est né à San Francisco en juin 1945. Son père est officier de marine et sa mère, une intellectuelle, le pousse à faire des études qui le mèneront jusqu’à étudier les sciences politiques à l’université de Berkeley. Il passera sa jeunesse bercé par le Surf-rock et les premières manifestations musicales du psychédélisme. De Jan & Dean au Grateful Dead, en quelque sorte. Marcus restera un marginal parmi les hippies de San Francisco, plutôt sceptique devant les utopies des enfants-fleurs, du pacifisme à l’amour libre en passant par la sagesse orientale. Marcus est un intellectuel, un étudiant qui ne prend pas trop au sérieux l’été de l’amour et ne s’est jamais remis de ses premières admirations : Elvis Presley, Little Richard ou Buddy Holly. Il a 15 ans à l’époque des roucouleurs du College rock et du Mersey beat, et ne manque pas le concert des Beatles à l’Hollywood Bowl. Sa voie est tracée, il sera un journaliste, un messager, au service de cette nouvelle musique, cette pop music que les groupes du Swinging London offrent à la jeunesse occidentale sous la forme de singles explosifs et d’albums en cadeau pour Pâques ou pour Noël.
Il prendra le nom de jeune fille de sa mère et sera journaliste comme on est évangéliste, témoignant inlassablement de l’avènement des apôtres britons – Saint John, Saint Paul, Saint George et Saint Ringo – qui auront sauvé la jeunesse d’un ennui que l’on aurait pu croire éternel. D’autant que dans le pays même, le messie Dylan y est allé de ses premiers oracles et les Beach Boys ont ouvert l’ère psychédélique avant le Folk-rock des Byrds, de Love ou du Buffalo Springfield et les groupes de San Francisco, du Jefferson Airplane à Quicksilver Messenger Service en passant par le Grateful Dead, Country Joe & The Fish ou Big Brother & The Holding Co. De tout cela et de bien d’autres choses, Greil Marcus se sent obligé de témoigner et il le fera avec talent, toujours avec une vision très personnelle du rock, de ses héros maudits et de ses fins dernières. Un évangile accordé aux adolescents boutonneux du monde entier. La religion des ratés ?
On est à l’automne 1967 et l’été de l’amour vient de s’achever. Après les ancêtres que sont Crawdaddy Magazine et les journaux pour professionnels (Billboard, Cashbox…), un nouveau magazine – Rolling Stone – est crée à San Francisco par une petite équipe autour de Jann S. Wenner, le fondateur, et de Ralph J. Gleason, journaliste spécialiste de jazz au San Francisco Chronicle. Fort de quelques articles écrits pour la presse universitaire, Greil Marcus propose ses services au journal et est intégré sans trop de difficultés. Il faut dire que le magazine en est à ses débuts et qu’il se vend comme des petits pains dans la jeunesse hippie. La petite équipe a du mal à tenir le choc et il faut recruter. Greil Marcus, une fois dans la place, va favoriser la venue de Lester Bangs, jeune punk de San Diego dont on a déjà raconté l’histoire.
À Rolling Stone, il est vite promu au rang de rédacteur en chef grâce à son goût très sûr en matière d’écrits, à ses connaissances musicales et à sa capacité d’analyse sur le rock et son contexte comme plus généralement sur l’industrie du disque et le music business. Car Marcus n’est pas homme à s’emballer devant les pop stars et leurs frasques. Il regarde lucidement ce petit monde comme le ferait un entomologiste avec ses insectes. C’est à la fois en historien, en philosophe et en sociologue qu’il va appréhender cet univers de sons et d’images dont il sera l’inlassable chroniqueur.
En même temps que Bill Graham, après avoir ouvert le Fillmore dans le quartier noir de San Francisco, va reproduire le même type de salle et de spectacles à New York ; Rolling Stone transportera son siège de San Francisco à New York à l’automne 1968. Il faut dire que l’été de l’amour s’est vite terminé et que dès l’automne 1967, les drogues dures ont fait leur apparition et San Francisco est devenue une cité où les overdoses et la criminalité ont atteint des proportions inquiétantes, dramatiques même.
Marcus a suivi le mouvement avec son nouvel ami Lester Bangs et, à New York, il va garder ses fonctions de rédacteur en chef tout en recrutant des journalistes de la grosse pomme, ceux-là même qui ont pu s’illustrer dans la presse locale : Richard Meltzer, Lenny Kaye, Sandy Pearlman, Murray Krugman, Danny Fields ou Richard et Lisa Robinson, plus la photographe Annie Leibovitz. Rolling Stone devient l’institution de la presse rock, comptant le plus de talents au mètre carré. Plus tard viendront les Hunter S. Thompson, Tom Wolfe, P.J O’Rourke, Norman Greenfield et tout un bestiaire de monstres sacrés du nouveau journalisme.
Lester Bangs s’est fait virer du journal à la suite d’une mauvaise critique du Back in the USA du MC5 qui n’a pas eu l’heur de plaire à la maison Atlantic. La cabale est lancée et on accuse Bangs de fumisterie et de légèreté. Marcus le défend et s’oppose à la direction qui l’envoie bouler à son tour. Les jeunes turcs de Rolling Stone ne font pas de sentiment et les journalistes se bousculent au portillon pour s’introduire dans la grande maison.
C’est donc à Creem Magazine, un mensuel de Detroit fondé par Barry Kramer à la fin des années 1960 que les deux compères vont échouer, en 1971. Dave Marsh, lui aussi ex de Rolling Stone, les suit et devient le directeur de la rédaction supervisant toutes les grandes plumes new-yorkaises arrivées à Rolling Stone. Meltzer, mais aussi Kaye, Nick Toshes et Bill Ward, en plus des poèmes de Patti Smith et des bandes dessinées de Rob Tyner, chanteur éruptif du MC5. « America’s only rock’n’roll magazine », tel est le sous-titre argument publicitaire, comme pour laisser entendre que Rolling Stone est devenu autre chose, un magazine culturel, mais que seul Creem a encore la foi dans le rock’n’roll. Bangs écrira sur tous les groupes de Detroit, sur le Free-jazz et bientôt sur le Punk-rock et on pourra saluer Creem pour avoir annoncé le genre, s’ils ne l’ont pas inventé avec Bangs.
Au milieu des années 1970, Bangs et Marcus – on croirait que leur sort est lié – quittent Creem et Detroit pour regagner New York. Ils vont travailler dans la presse gauchiste de Big apple, Village Voice et Village Vanguard. Là où Bangs va s’enfoncer dans les drogues dures sans espoir de retour, Marcus va se réinventer dans les livres, avec des biographies incomparables et surtout des essais de première importance. Il réintégrera à la fin des années 1970 la rédaction de Rolling Stone, avec toujours Bangs, mais pour plus longtemps puisque son ami décédera en 1982.
Ce sera d’abord Mystery train, qui réunit sur le mode de l’épopée Robert Johnson, Elvis Presley, Sly Stone et Randy Newman. Un carré d’as pour une vision originale du rock, ses origines populaires et ses racines dans la société américaine. Comment les chansons se répondent, se télescopent, se transforment d’un auteur à l’autre.
Lipstick traces, en 1989, montre vraiment de quoi il est capable. Un essai stimulant qui part des sociétés secrètes gnostiques du Moyen-âge pour en arriver au Punk en passant par les dadaïstes et les situationnistes. Un essai littéralement vertigineux et passionnant qui dépasse largement le cadre de la musique pour entrer de plain-pied dans la mystique et la philosophie. C’est puissant, documenté, captivant et ça renvoie à leurs chères études pas mal d’essayistes médiocres.
Dead Elvis est une compilation de ses articles sur Presley, mais on se régale. Il faut attendre La république invisible (Bob Dylan et l’Amérique clandestine) pour retrouver la veine politico-mystique, qu’on pourrait aujourd’hui qualifier de complotiste, de Lipstick traces avec cette fois la réclusion de Dylan après son accident de moto avec le Band dans une Amérique de plus en plus paranoïaque.
Dylan, son maître, qui va encore l’inspirer pour deux forts ouvrages : Like a rolling stone : Bob Dylan à la croisée des chemins, uniquement sur l’enregistrement de la chanson-manifeste et Bob Dylan, une compilation de ses écrits sur Dylan.
L’Amérique et ses prophètes : la république perdue ? renoue avec ses obsessions sur le pays, sur la nation. Comment le pays de la liberté et de l’enthousiasme des pionniers a-t-il pu devenir ce cloaque où règnent la cupidité, la vulgarité et la folie pure.
Il est encore question de Dylan pour Three songs, three singers, three nations qui décortique « The ballad of Hollis Brown » comme deux chansons d’obscurs bluesmen dont le « Last Kinds Words Blues » de Gheeshie Wiley et le « I Wish I Was A Mole In The Ground » de Bascam Lamar Lundsford ; son propos étant d’expliquer en quoi ces trois traditionnels des documents fondateurs de l’identité américaine. L’Amérique, l’éternelle obsession de Greil Marcus.
Tout n’a pas été traduit, et l’avenir nous réserve d’autres chefs-d’œuvre de Marcus, notamment une biographie des Doors, entre autres essais originaux dont l’un associe Presley et Bill Clinton.
En fait, Greil Marcus est un moraliste inconsolable de la disparition d’une Amérique largement fantasmée. Mais il a l’immense talent de rendre cette Amérique réelle et désirable, mystérieuse et magique. Une nouvelle Jérusalem dont Dylan, Presley et Morrison seraient à la fois les prophètes et les martyrs.
24 mai 2022
Merci Didier pour ce rappel magistral.