NOTES DE LECTURE (31)
FRANÇOIS MAURIAC – LES ANGES NOIRS – Grasset / Le livre de poche.
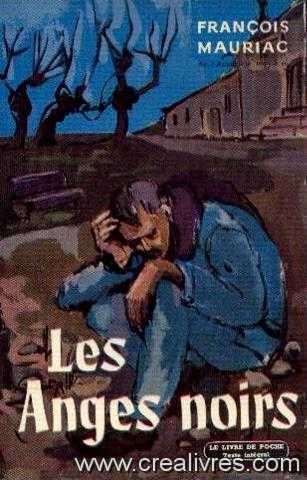
C’est loin d’être le meilleur Mauriac, même si tous les ingrédients sont là. Les anges noirs ne peuvent rivaliser avec Thérèse Desqueyroux, Le nœud de vipères ou Le mystère Frontenac. Mais bon, on y trouve quand même son compte, pour celles et ceux en tout cas qui ont des bontés pour l’écrivain catholique n°1. Les familles je vous hais, les mariages arrangés en fonction des terrains et des pins des Landes, les curés à la Bernanos, bouc-émissaires d’une communauté sans la miséricorde du Christ, et le mal sous toutes ses formes dissimulé sous une couche de mondanités et de traditions. Précisons que le talentueux Mauriac n’a jamais eu le génie tourmenté de Bernanos.
Gabriel Gradère, un vieux viveur qui s’accuse de tous les péchés d’Israël, rédige ses confessions au curé de son patelin dans les Landes. Fils de métayer, il a fait un beau mariage avec la fille du château, Adila, avant de la répudier et d’aller courir la gueuse à Paris. Adila mourra tôt, en sainte et martyr, et il a eu un fils d’elle, Andrès, qui se trouve être à l’exact opposé de son père, scrupuleux, honnête et dévoré d’amour pour la sœur du curé – Tota – accusée publiquement d’être une catin. Mais la famille a déjà choisi pour lui : il épousera Catherine, la fille de Mathilde, elle-même sœur d’Adila, et de Symphorien, le pater familias.
Pour déjouer les plans de Gabriel, qui vise la terre et les biens à travers le mariage de son fils et de Catherine, Symphorien et Mathilde veulent faire intervenir Aline, une prostituée rencontrée à Bordeaux, devenue une demi-mondaine alcoolique vivant avec lui à Paris. Elle arrive et, à la faveur de la nuit et de la pluie, Gabriel supprime celle qui pouvait le faire chanter pour ses louches affaires sentimentales avec une aristocrate dont il a bafoué l’honneur en la dénonçant à son mari, pour de l’argent.
L’affaire finira mal, on s’en doute, et on est dans ces drames en clair-obscur où s’ébattent des gens fatigués de vivre et seulement guidés par l’argent et les terres. On ne voit plus la province française, et le Sud-ouest en particulier, de la même façon après avoir lu Mauriac, et on retient sa férocité contre cette bourgeoisie terrienne et, plus généralement, son désespoir devant la condition humaine.
Ce livre peut se lire comme un roman policier avec un crime mais, à ce compte-là, autant dire que le Crime et châtiment de Dostoïevski en est un aussi. En chrétien, Mauriac convoque dans les pages ultimes la rédemption du pécheur et l’amour de Dieu qui sauve tout le monde dans la réconciliation et le pardon. On n’est pas obligés d’adhérer.
Sartre, qui reprochait à Mauriac d’être derrière tous ses personnages, comme un dieu qui les aurait créés, a dit : « Dieu n’est pas un artiste, François Mauriac non plus ! ». Le bon mot est connu, sauf que Mauriac est certainement meilleur romancier que Sartre et que ses plongées dans l’obscurité de l’âme humaine sont toujours actuelles, 80 ans plus tard.
HENRI JEANSON – EN VERVE – Pierre Horay
En verve, une délicieuse collection jadis dirigée par le docteur en pataphysique François Caradec. On y trouvait les bons mots, propos, aphorismes et apophtegmes d’esprits brillants comme Alphonse Allais, Raymond Queneau ou Paul Léautaud.
Ici, c’est Jeanson, célèbre dialoguiste de moult grands films des années 1930 aux années 1950, surtout ceux des 3 D (son ami Duvivier, Delannoy et Decoin) honnis par la nouvelle vague. Jeanson commence à tâter du journalisme (une feuille théâtrale appelée Bonsoir en même temps que le journal de la CGT) et de la mise en scène de théâtre dès les années 1920. Emprisonné à la Santé en 1939 pour ses écrits pacifistes, notamment dans le journal de Louis Lecoin, il se tape 18 mois de prison avant de vivre en clandestin jusqu’à la libération.
Il devient critique de cinéma sous pseudonyme au Canard Enchaîné et il s’en fera viré après un article sur Aragon et Triolet désavoué par la direction. Il ne quittera pas la presse et, dans les années 1960, sera critique de télévision à l’Aurore tout en émargeant au Crapouillot.
Pacifiste et anar (plutôt de gauche), Henri Jeanson est aussi anticommuniste qu’antinationaliste. Il a été fait satrape du collège de pataphysique et se distingue pour ses talents de polémiste en même temps qu’il est un grand humoriste devant l’éternel, auquel il ne croyait d’ailleurs pas.
Le livre classe par thèmes ses bons mots : Jeanson l’antimilitariste, Jeanson et l’amitié, Jeanson et les femmes, Jeanson et la politique… On trouve en fin de volume ses meilleurs dialogues au théâtre et au cinéma. On remarque en passant que ses dialogues les plus réussis sont ceux de Paris au mois d’août, d’après un roman de Fallet. Comme quoi ça aide de travailler derrière un grand auteur. Bizarrement, on ne trouve pas sa critique restée fameuse du Golgotha de Duvivier : « et Gabin, en Pilate, qui s’en lave les pognes ».
Mais on retient de ce livre le ton vachard, la réplique qui tue. On sent que Jeanson n’est pas un tendre ni un tiède et il a ses têtes. C’est le casse-pipe pour des importants comme Mauriac, Claudel, Gide, Montherlant, Ionesco, Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Salacrou, Cocteau et beaucoup d’autres. Côté cinéma, c’est toute la nouvelle vague qui y passe, plus Bresson, André Bazin, Les Cahiers du cinéma et tous les films qui privilégient la forme au fond, à l’histoire, au scénario et aux jeux d’acteurs.
On pourrait citer plusieurs mots d’auteur, mais on va se contenter de ça, où la vacherie cède la place à une poésie mélancolique confinant au génie : (à propos d’un acteur nommé Jacques Deval) je crois que ce Parisien souriant n’a aucune illusion quant à la postérité. Il sait que nous autres civilisations sommes mortelles et que, dans quelques centaines d’années, Molière, Feydeau, Paul Valéry, Sheila, Gide, Platon, Sylvie Vartan, Malraux, Maurice Chevalier, Eschyle, le monumental immortel Claudel, Jean-Paul Sartre, Jacques Deval et le général aux dimensions historiques, comme disent les radicaux, seront tous logés à la même enseigne. Pompéi, tout le monde descend ».
C’est d’un moraliste, du Bossuet. Jeanson est de la même trempe qu’un Guitry ou un qu’un Audiard, mais il n’a pas le côté mondain du premier ni le cynisme fleurant l’anar de droite du second.
Un grand bonhomme en résumé, qui connaissait les travers de ses contemporains et savait le poids des mots pour les ridiculiser.
HONORÉ DE BALZAC – LES CHOUANS – Le livre de poche
Les premiers écrits de Balzac sont des romans historiques où il marche sur les brisées de Dumas père. Les chouans appartiennent à cette catégorie et on peut préférer le Balzac de la maturité. La préface nous dit que le jeune Balzac se rêvait en Walter Scott et que son ambition était d’écrire un Ivanhoé à la française. On doit avouer préférer le vieux Scott et ses chevaliers moyenâgeux.
L’action se passe en 1799. À l’extérieur, les armées de la République sont défaites sur tous les théâtres de guerre européen et le premier Consul va renverser la vapeur. À l’intérieur, l’armée des bleus traque les dernières poches de résistance royalistes, non pas en Vendée où ils sont matés, mais entre le bocage Normand et la première ville de Bretagne, Fougères.
Trois longs (trop longs) chapitres. Le premier sur la route (que je connais par cœur pour des raisons familiales) entre Fougères et Mayenne, une embuscade des Chouans contre les bleus au lieu-dit La Pèlerine. Le deuxième nous conduit au plus près des protagonistes et s’attarde sur l’idylle naissante entre Le gars, en fait le chef de la Chouannerie, et Marie de Verneuil, une aristocrate passée du côté républicain. Amour contrarié par un dandy stipendié par Fouché, lui aussi amoureux de l’héroïne. Le troisième, le plus long, nous fait vivre les faits d’arme, les trahisons, les jalousies et les rebondissements en prélude au siège d’un hôtel de Fougères où les amants tragiques vont trouver la mort sous le feu des Républicains.
Autant dire que ce n’est pas mon Balzac favori. Sans avoir tout lu de lui (la tâche est ardue) j’ai ma trilogie : La peau de chagrin en tête, qui côtoie le fantastique, Le Cousin Pons et sa magnifique préface de Blondin et Le lys dans la vallée, peut-être le mieux écrit.
Ici, trop de digressions, de dialogues d’amoureux qui tiennent plus de la fleur bleue que du romantisme, trop de descriptions, trop de précisions historiques… Trop de tout. Un Balzac obèse qui ressemble à du Victor Hugo, qui prend son temps, qui musarde et nous assomme de détails et de digressions ; sans que la lecture ne se fasse dans l’allégresse, c’est le moins qu’on puisse dire.
Balzac a eu à cœur de décrire un grand amour, si ce n’est un amour fou : l’amour dont il rêvait jeune homme, avec son physique plutôt ingrat. Un amour qu’il essaiera de vivre avec Mme Hanska, même mal. Voilà, on avoue lui préférer Flaubert, Stendhal, Dumas ou Maupassant, plus tous les auteurs « fin de siècle » au premier rang desquels Huysmans, Léon Bloy ou Villiers de l’Isle Adam. Mais bon, c’est Balzac, tout de même, l’ancêtre de tous les forçats de la littérature. Alors, un peu de respect, monsieur l’écrivaillon !
L.C MOYZISCH – L’AFFAIRE CICÉRON – Julliard / J’ai lu
Encore un roman trouvé dans une boîte à livres, ou plutôt un document qui tient du roman d’espionnage. Le livre a paru en 1950, écrit par un dignitaire du régime nazi ambassadeur du reich en Turquie, à Ankara. La Turquie se déclara neutre durant la seconde guerre mondiale et les Allemands comme les alliés y avaient leur ambassade.
On se souvient du film remarquable qu’avait tiré Mankiewicz de cette histoire, avec James Mason en Moyzisch et Danielle Darrieux en secrétaire hystérique. C’est à vrai dire ce film qui m’a donné l’envie de lire ce livre, n’étant pas spécialement attiré par un auteur de ce calibre et son côté « quand les nazis écrivent l’histoire ».
C’est une histoire d’espionnage incroyable : un valet de chambre de l’ambassade d’Angleterre (nom de code Cicéron pour son éloquence) transmet des documents ultra-confidentiels au chef de l’ambassade allemande. Ses raisons ? Il déteste les Anglais et son père, un Albanais, a été tué par un sujet de sa majesté lors d’une partie de chasse.
C’est une autre partie de chasse qui se joue ici. Les documents sont envoyés un à un à Berlin et une étrange amitié s’établit entre Moyzisch et Cicéron. En haut-lieu, Ribbentrop, le ministre des affaires étrangères, et Kaltenbrunner, son second, n’ont de cesse que de trouver l’identité du traître, sans jamais accorder foi aux documents eux-mêmes qui annoncent pourtant le désastre du reich avec la conférence de Téhéran, celle du Caire, la création d’un deuxième front et jusqu’au débarquement des alliés sous le nom de code Overlord. Les rapports exécrables entre Moyzisch, son supérieur Von Papen et les hauts dignitaires à Berlin font aussi le sel de ce récit, avec rappel d’ambassadeurs et dialogues ciselés.
Une secrétaire indélicate et deux aviateurs allemands déserteurs viendront épicer un récit qui nous laisse haletant et on avale goulûment ces 200 pages qui témoignent d’une histoire vraie, laquelle ne fait pas honneur aux nazis. Moyzisch sera grillé à Berlin et il se tiendra tranquille en Turquie avant d’être jugé et relaxé au procès de Nuremberg. En dépit de plusieurs propositions des Anglais pour se tirer du guêpier allemand en voie de destruction, il restera jusqu’au dernier jour au service du reich, par patriotisme, par fidélité.
Il vilipende l’état-major nazi qui n’a pas voulu prendre en compte les avertissements donnés par Cicéron : « c’étaient de faux politiciens. Il paraît étrangement logique qu’ils aient payé des renseignements qu’ils étaient incapables d’utiliser, avec de faux billets ». Un beau résumé de l’affaire Cicéron. Et un document passionnant, digne des fictions d’un Le Carré ou d’un Graham Greene. C’est assez dire à quel niveau on se place. Cicéron, c’est point carré, comme on disait dans nos cours de récréation.
8 juillet 2022
Je ne savais pas (non plus…) que c’est Jeanson qui a écrit les dialogues de « Paris au móis d’aout » Mais je me souviens tres bien; de la dernière réplique de ce film vu lors de sa sortie, il y a pas loin de 60 áns.,
Rentrée de vacances, la femme du héros (Aznavour) lui dit au petit dé »jeuner: « Ah bon, tu bóis du thé maintenant ? »
Qu’est-ce que j’aimerais revoir ce film ! L’une des meilleures chansons d’Aznavour en plus, avec « Me voilà seul ». Ça me fait penser à une anecdote sur Fallet, lorsqu’il invitait André Hardelet dans son patelin de l’Allier, il délaissait le Beaujolais pour le thé, à la grande surprise de ses compagnons de beuverie. C’est son beaui-frère (le frère d’Agathe, sa femme), qui m’avait raconté ça à Jaligny.
Encore une fois, merci Didier pour ces partages d’ouvrages que je n’avais pas lus.