NOTES DE LECTURE 48
SAN ANTONIO – CHAUDS LES LAPINS ! – Fleuve noir.
Un vieux San-A trouvé dans une boîte à livres, toujours la même. Un San-A des années 1980, pas forcément les meilleures pour lui. C’est l’époque très cul avec un Bérurier devenu ministre de l’intérieur et Achille, le directeur de la police, poussé vers la sortie. Tout cela ne tirerait pas trop à conséquence si on ne sentait pas que Dard prend trop de distance avec son œuvre, délirant à qui mieux-mieux sans plus se soucier de la moindre crédibilité de ses histoires. C’est du pur délire verbal, inspiré certes, mais qui sent un peu trop la virtuosité.
L’intrigue ? Béru est donc ministre de l’intérieur et, à ce titre, convié à un congrès d’Interpol à Amsterdam. Son épouse, Berthe, est du voyage et, durant le colloque, elle a fait du lèche-vitrines dans le quartier chaud. Elle est enlevée et conviée à une partouze dont les photographies pour le moins cochonnes servent à un chantage. Béru quitte ses fonctions sur les conseils de San-Antonio qui va essayer de démêler l’écheveau.
Puis la gravosse est droguée et conduite dans un bateau où elle est honorée par tout l’équipage. D’autres photos sortent, directement adressées à toute la presse française. Scène hilarante qui voit Serge July et Louis Pauwels – respectivement directeurs de Libération et du Figaro Magazine à l’époque – jurer de leurs grands dieux devant Achille et San Antonio qu’ils ne mangeraient pas de ce pain-là. Dans l’intérêt du pays et au-delà de leurs divergences politiques. Une Marseillaise serait la bienvenue.
Un armateur devenu fou, le chef de la police hollandaise qui se livre à toutes sortes de trafic avec le milieu (drogue, prostitution, terrorisme, ventes d’armes…). On va de personnage en personnage sans perdre le fil de l’action avec des scènes cocasses qui font le charme des petits San Antonio. Pinaud est même là, discret et furtif, et Achille, le dabe, redevient chef de la police à la faveur de la démission de Béru. Bref, on se marre. Il y a même à la fin un projet déjoué d’assassinat du président concomitant avec un attentat terroriste contre la Tour Eiffel. Bref, le grand jeu.
Allez, on lui passe tout à Frédéric Dard, moi qui ai quasiment appris à lire dans ses livres. J’avoue quand même préférer les San Antonio des années 1950 – 1960, ceux qui étaient tout aussi drôles, moins axés sur le cul et où les intrigues tenaient encore debout. C’était avant que San Antonio ne devienne le sujet de thèses universitaires et que Frédéric Dard ne soit pris trop au sérieux, lui qui ne se voulait rien d’autre qu’un artisan, le « steak-frites » de la littérature, comme on a pu dire et comme il le disait lui-même.
N’empêche, il avait inventé un genre, le polar humoristique, sur les brisées des Albert Simonin et autres Léo Malet. Un foutu écrivain en plus, artificier des mots et fin connaisseur de la vie et des hommes. Y’ a bon San Antonio !
GUSTAVE LE ROUGE – LA GUERRE DES VAMPIRES – 10/18.
Ce cher Le Rouge, l’un des grands noms de la littérature populaire fin de siècle, avec ses confrères de couleur : Maurice Leblanc ou Gaston Leroux. Sauf que Le Rouge peut aussi être considéré comme un pionnier de la science-fiction. Pas à base scientifique, certes, mais en plein merveilleux, avec une dilection pour le mystère et l’ésotérique.
On connaissait de lui le personnage du Docteur Cornelius, savant fou et personnage loufoque. On est ici dans les mêmes eaux, même si on peut considérer que Le Rouge penche plus vers H.G Welles, Jules Verne ou encore Arthur Conan Doyle, voire vers les B.D d’Edgar P. Jacobs.
L’action se passe dans une propriété proche de Bizerte, en Tunisie. Un aréopage de scientifiques écoute le héros, Georges Darvel, raconter les mésaventures de son frère R obert, censé avoir disparu sur Mars. Il y a là Miss Alberte, l’héroïne, Ralph Pitcher, naturaliste, le capitaine Wad et l’ingénieur Bolenski. Plus le petit personnel, la servante Cherifa, un vieux serviteur aveugle du nom de Zarouk et le cuisinier Frymcock, un vieil excentrique anglais. Zarouk sent les choses et il sent des djinns autour de lui. Des djinns qui vont s’avérer être des vampires.
Une météorite explose qui fait périr Wad et Bolenski mais Robert Darvel, le frère de Georges, est retrouvé exsangue dans un mausolée de pierre trouvé à l’intérieur de la météorite. Pendant près de 200 pages, il va pouvoir conter son aventure. Son voyage sur Mars propulsé par l’énergie psychique de milliers de yogis tous concentrés vers le même but. Là, il a à affronter toutes sortes de bestioles maléfiques, dont des êtres qui sont de véritables cerveaux ailés, les vampires. Les martiens, eux, ou plutôt les Eelors, l’ont plutôt eu à la bonne, mais ils sont décimés par les vampires. Darvel a introduit l’eau et le feu sur la planète et, après un voyage extraordinaire dans des vallées de cendre, des tours de cristal et des fosses marines, il découvre le secret de la planète : le grand cerveau, une masse de cervelle dont la boîte crânienne est une montagne. C’est lui qui fait tourner son monde grâce à un réseau de câbles électriques que l’on pourrait prendre pour des neurones et des synapses.
Le grand cerveau expulse Darvel de sa planète et on a vu comment il est retombé dans le salon de ses amis. Puis c’est la pauvre Alberte qui est enlevée par 15 vampires invisibles qui veulent amener le héros à revenir combattre le grand cerveau. Tout sera bien qui finira bien. Darvel épousera Alberte, le cuisinier Frymcock se mettra au service du tsar, Pitcher et Robert chercheront le moyen de se rendre invisibles et les vampires deviendront une légende chez les villageois arabes, expliquant tous leurs malheurs.
Voilà, une histoire abracadabrantesque à base de parapsychologie et de merveilleux qui fait penser, dans les meilleurs moments, à Lautréamont pour les descriptions d’outre-monde. Le Rouge se sert des découvertes scientifiques les plus récentes (on est au début du XX° siècle) pour soutenir un récit complètement loufoque et fantasmagorique. À lire comme un roman de genre fantastique, voire comme un pionnier de l’Héroïc-Fantasy, mais le style est alerte et si certaines pages sont de la poésie de la plus belle eau.
Les surréalistes adoreront Le Rouge qui fut aussi proche des milieux socialistes utopiques, en anticapitaliste avant la lettre. Blaise Cendrars s’inspirera du personnage de Le Rouge pour son Homme foudroyé et Francis Lacassin le mettra à l’honneur dans sa collection L’aventure insensée chez Bourgois 10/18. Le Rouge portait bien son nom.
VICTOR HUGO – LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ À MORT – Librio
Ce petit livre, à peine 100 pages, du grand Victor (lui qui nous a habitués aux pavés en deux ou trois tomes) peut toujours servir de bible aux abolitionnistes du monde entier.
Sans l’épithète hugolien et le style parfois ampoulé du maître, il fait écho au récit de Dostoïevski sur le simulacre de fusillade qu’il a eu à subir par les sbires du tsar pour ses activités subversives. Hugo raconte donc, comme l’indique le titre, les ultimes jours d’un condamné à mort dont on sait à peine le nom et dont on ignore exactement la nature du crime.
On sait juste qu’il a une mère, une épouse et une petite fille et qu’il a eu une enfance plutôt heureuse avant les difficultés de l’âge adulte et les premières incartades, mais l’auteur n’est pas disert là-dessus et il faudra se contenter de l’angoisse et du désespoir de quelqu’un qui va mourir au nom de la justice des hommes.
Le condamné espère encore un peu à un pourvoi en cassation qui lui est refusé et, dans sa cellule de Bicêtre défilent les dernières figures d’une société qu’il s’apprête à quitter : huissier, administration pénitentiaire, curé… À la fin, il communique avec un condamné qui va prendre sa place en cellule, un pauvre bougre qui n’a jamais pu trouver de travail après avoir été marqué du sceau d’infamie « ancien bagnard à Toulon», et il a volé un pain, comme Jean Valjean, un méfait qui s’ajoute à une longue liste et lui vaut la peine de mort.
Outre les affres du condamné et son désespoir de plus en plus profond à mesure que les heures passent, outre ses souvenirs, ses regrets et la simple contemplation de ce qui l’entoure, on a le récit détaillé de l’exécution.
Une exécution qui s’effectue sans drame, en bon ordre, dans un cérémonial civil mille fois rodé. C’est presque avec une infinie courtoisie qu’on va le mener sur la bascule à Charlot et lui trancher le cou. Rien de personnel, c’est la société qui le veut. Des spectateurs morbides sont déjà massés là et on va au supplice comme on irait au théâtre. La mort est donnée et la société se félicite d’être débarrassée d’un nuisible ; chacun dans la foule ignorant qu’il peut subir le même sort, en fonction des circonstances.
Et on se dit qu’avec 60 % des Français pour le maintien de la peine de mort, il a fallu quand même du courage à Badinter et au gouvernement Mauroy pour réussir à bannir ces cérémonies barbares. Et on se dit aussi que le vrai courage politique est tout le contraire de la démagogie, du populisme et du suivisme de l’opinion. Hugo le savait mieux que personne au XIX° siècle et nous devrions le savoir beaucoup mieux encore, si la notion de progrès était établie. Mais chaque jour qui passe nous rapproche pourtant de la barbarie. On dirait aujourd’hui à Hugo : « t’as tort Totor, tu t’entêtes et t’as tort », sur l’air de la chanson de Milton (pas Alfred, Georges).
STEFAN ZWEIG – MARIE STUART – Grasset / Le livre de poche
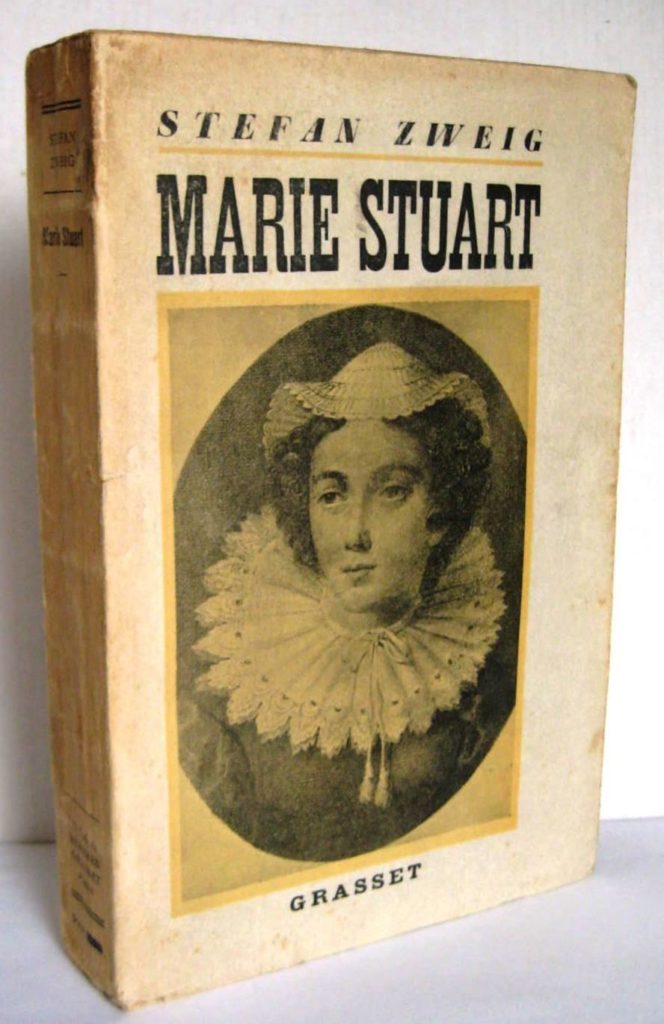
Les lecteurs attentifs de ce blog savent que Stefan Zweig a toujours été l’un de mes héros littéraires. Plume élégante, intelligence aiguë, immense sensibilité au monde qui l’entoure et humanisme quasi-militant. La vie de Zweig est exemplaire, un phare d’humanité dans un siècle barbare, et son suicide à Petropolis (Brésil) en 1942 après avoir fui le nazisme en est l’aboutissement presque logique. De Marie Stuart, reine d’Écosse, il fait une Jeanne d’Arc, mais une sainte sanglante.
C’est ici moins le nouvelliste hors-pair et le romancier passionnant que l’historien qui parle et qu’on lit. Une biographie romancée, on va dire, ou un solide travail d’historien qui n’aurait pas oublié qu’il est aussi un grand écrivain. Marie Stuart, la reine d’Écosse au destin tragique avait tout pour inspirer un Zweig qui a connu Freud et tous les illustres auteurs (Schnitzler, Sacher-Masoch, Musil, Kafka) d’un Empire Austro-hongrois en voie de dislocation, en déliquescence.
La reine au destin tragique, née coiffée et morte décapitée, est la fille de Jacques V et de Marie De Guise-Lorraine, farouchement catholique (c’est important de le souligner dans le contexte du livre). Elle épouse François II, enfant chétif qui meurt après les noces et devient reine d’Écosse après avoir, en demoiselle farouche aidée de ses conseillers, avoir réduit l’hostilité des lords écossais, ces hobereaux querelleurs qui lui disputent le pouvoir. Zweig décrit cette Écosse de l’époque comme un pays rural, sauvage et éloigné de tout, loin des fastes des cours européennes, des lumières de la Renaissance et de l’Angleterre élisabéthaine. Il insiste sur le fait que cette période de l’histoire anglaise est aussi celle d’un Shakespeare ou d’un Ben Johnson, un siècle d’esprit et de grandeur.
C’est bien la mort qui la poursuit tout au long de son court règne. La mort de son mari François II puis la conspiration des lords contre Darnley qui allait devenir roi d’Écosse, puis encore l’assassinat de Riccio, son secrétaire et confident et enfin l’exil de Bothwell, le rustre hobereau sans foi ni loi qui avait ravi son cœur, ce Bothwell dont elle s’entiche comme une midinette et cette passion sera à l’origine de son drame comme de sa chute.
C’est aussi le siècle de Machiavel et tout est bon pour accéder au trône ou pour se voir concéder un peu du pouvoir royal. Les couteaux sont aiguisés et les poisons préparés. Elizabeth épie les moindres mouvements de sa demi-sœur qui peut encore revendiquer le trône d’Angleterre à sa mort, et ses conseillers ourdissent les complots les plus noirs contre Marie Stuart. Des pièges dans lesquelles elle tombe sans être dupe du mal qu’on lui veut. Il ne faut pas non plus négliger la dimension religieuse du drame qui se joue. L’Angleterre est phare du protestantisme quand l’Écosse se veut le refuge des catholiques de cette contrée d’Europe. John Knox, un prédicateur calviniste, lève les foules contre la reine catholique et, après sa passion avec Bothwell, elle est rejetée par tout son peuple comme reine homicide et catin royale.
On suit le cours de sa déchéance, sa prison dorée en Angleterre, sous l’œil inquiet d’Elizabeth après une longue traque sur ses terres d’Écosse. On suit les complots avortés qu’elle ourdit avec l’aide peu empressée de toutes les cours d’Europe, d’Espagne et de France. Elle croit encore possible son destin de reine d’Angleterre, mais les têtes couronnées la considèrent comme une folle encore animée par des rêves de grandeur.
Puis c’est la sentence et l’exécution. Marie Stuart affronte la mort avec courage et lit la bible en latin alors qu’un prêtre protestant commence son homélie. Elizabeth, reine hypocrite, dira qu’on l’a exécutée sans qu’elle n’ait donné d’ordre formel. Elle croit en son mensonge et, pour le rendre plus crédible encore, elle frappe de disgrâce tous ceux qui ont agi pour la mise à mort. Jacques VI, le fils de Marie, déjà prévenu contre sa mère, est fait successeur de la reine d’Angleterre. Tout rentre dans l’ordre. Henri III fait dire une messe et Philippe II ne peut que constater la déroute de sa pas si invincible armada. Rules Brittania ! Jacques VI sera roi à la mort d’Elizabeth sous le nom de Jacques Premier et les deux reines mortes dormiront côte à côte à Westminster, pour l’éternité.
21 mai 2023
Mercio, Didier, pour ces introductions à des ouvrages que je ne connaissais pas.
Merci pour la piqure de rappel Sana ! Comme toi, je pense les avoir tous lus ! Les seuls bouquins qui ont entendu et vu mes éclats bruyants de- et mes fous- rire en direct !