introduction Biblio pop
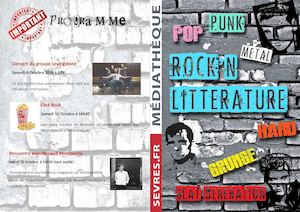
Je devais avoir 12 ans, juste au sortir d’une enfance innocente et je venais de troquer la B.D belge (les éditions Dupuis à Marcinelle) pour mes premiers San Antonio (Mange et tais-toi, Faut être logique…). Il faut bien dire qu’en dehors de cette sous-littérature tant décriée par nos maîtres, je n’étais pas un grand liseur et les livres de la bibliothèque verte me tombaient des mains.
1968 m’avait rapproché de Jack Kerouac et des poètes de la Beat generation dont j’entendais parler sur Campus par la voix d’un Michel Lancelot. Des petits livres en Folio ou en 10/18, mais je n’étais pas encore prêt pour le lyrisme d’un Ginsberg ou les cauchemars paranoïdes d’un Burroughs. Cela viendrait plus tard.
Ce n’est qu’un an plus tard que j’entrais à pas de clerc dans le monde des livres par l’intermédiaire de la presse rock. Il y avait Marjorie Alessandrini dans Rock & Folk et un certain Jean Mareska dans Best.Tous deux avaient une dilection pour la poésie Beat, pour les essais sociologiques sur la jeunesse, pour les ouvrages sur le rock ou le jazz, pour la science-fiction (qu’on appelait à l’époque « speculative fiction ») et pour le polar. Tous genres populaires qui convenaient parfaitement à une jeunesse iconoclaste lasse des classiques et des romans vantés par la clique des critiques littéraires mondains et tellement conventionnels quant à leurs goûts .
Nous avions étudié Rabelais et Montaigne en classe de seconde et allions découvrir Voltaire, Rousseau et Diderot en première avant les classiques du XIX° en Terminale. Tout cela était de peu d’intérêt devant les merveilles que nous faisait découvrir une Marjorie Alessandrini dans sa rubrique Presse / Livres.
Sur ses conseils, on pouvait lire une biographie de Charlie Mingus (Less than a dog), les classiques de la Speculative-fiction des Silverberg, Spinrad, Dick, Ballard, des inédits de Kerouac (Visions de Gérard), des essais comme Les Barjots, de Jean Monod sur les blousons noirs et de la bande dessinée américaine avec, en tête de colonne, les Shelton, Crumb, Wilson et autres Jim Franklin ou Jay Lynch. La dame était passionnée également par la littérature fantastique, celle des H.P Lovecraft, Arthur Machen, Matthew G. Lewis ou Charles M. Mathurin. Chip thrills ! Elle nous entretenait aussi d’écrivains français atypiques aux marges de la science-fiction comme Jacques Sternberg, Jean-Pierre Andrevon, Gérard Klein ou André Ruellan.
Comme le voulait le titre de la rubrique, il y avait aussi la presse avec des notules sur la presse underground (Actuel, Tout, Zinc), sur la presse bête et méchante (Charlie Hebdo, Hara Kiri) et sur des publications plus politiques comme L’internationale situationniste, ou carrément ésotériques comme le Planète des duettistes Pauwels et Bergier. Les deux avaient tout de même consacré un numéro spécial à Dylan.
Bref, avec elle, j’avais attrapé le virus de la lecture et toutes mesures de prophylaxie s’avéraient inutile. Je ne souhaitais pas le moins du monde qu’on me guérisse de ce vice impuni qu’était la lecture, selon une formule due au critique littéraire Claude Roy, que j’avais trouvé belle.
Je collectionnais les livres de poche et révisais des classiques qu’en fait je n’avais jamais lu. Je faisais les bouquinistes, les brocantes et les libraires pour accumuler ces objets transactionnels vers la beauté et le savoir.
Les références à la poésie et à la littérature que j’avais cru percevoir dans quelques vers des chansons rock ou dans certaines interviews de pop stars se révélaient maintenant dans toute leur clarté. Des pléiades et des nébuleuses naissaient : Dylan, Rimbaud et les saintes écritures ; Jim Morrison, Artaud, William Blake et Castaneda ; Lou Reed, Hubert Selby et Delmore Schwartz ; Procol Harum et la poésie romantique anglaise ; Steppenwolf, Herman Heisse et William Burroughs… Je comprenais que les deux univers étaient proches et, si la musique avait jusque-là pris le pas sur les mots, je n’en étais que plus attentif à des textes qui me renvoyaient souvent aux écrivains et aux poètes.
Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature et les livres de Patti Smith figurent à la vitrine de toutes les bonnes librairies. Leonard Cohen a été romancier avant de troquer la plume pour la guitare sèche. Jim Morrison a sorti des recueils de poésie et des pop stars comme Ray Davies ou Pete Townshend ont sorti des ouvrages ne ressortissant pas à la biographie. On pourrait aussi, pour mieux préciser encore la porosité entre les deux mondes, les livres de Mick Farren, de Richard Hell, d’Elliot Murphy ou de Nick Cave. Mais, outre ces rockers écrivains sur lesquels nous reviendrons, il est plus intéressant de chercher des thèmes et des influences littéraires dans les chansons et les albums de nos chanteurs et groupes favoris.
De tels rapprochements sautent aux yeux. D’abord les rapports avec les saintes écritures dans les œuvres de Dylan, du Band ou de Cohen. Sans être un exégète de la bible et des évangiles, les références sont souvent explicites et il est difficile de comprendre ces auteurs sans s’être frotté au judéo-christianisme, à ses mythes et à ses légendes.
Keith Reid avec Procol Harum ou Pete Sinfield avec King Crimson ont abondamment puisé dans la poésie des romantiques anglais, les Shelley, Keats, Coleridge et autres Byron. Procol pour la métaphore marine et Crimson pour l’imagerie médiévale.
Le Jefferson Airplane s’est inspiré de Lewis Carroll et le mouvement psychédélique a largement puisé dans les textes des surréalistes, Robert Hunter (pour le Grateful Dead) en tête. Plus tard, un gang d’allumés de Cleveland (Ohio) prendra pour nom Pere Ubu, en fins connaisseurs de Jarry.
Les poètes fin de siècle ont toujours projeté leur ombre fantomatique sur le rock. Patti Smith avec Rimbaud bien sûr, sans parler des Doors, mais Tom Verlaine n’a pas choisi son patronyme pour rien. Zappa et Beefheart se sont inspirés des délires dada qu’ils ont essayé de mettre en musique et les poètes de la Beat generation ont irrigué toute la vague psychédélique et l’Acide rock. Après tout, Ferlinghetti tenait une librairie à San Francisco, dans le quartier hippie.
Il ne faut surtout pas oublier les écrivains de la génération perdue, les Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, Miller ou Dos Passos qui ont laissé des traces dans le rock américain.
L’Angleterre n’est pas exempte, et la révolte de la jeunesse du baby boom à l’origine du British Beat et du Swinging London a beaucoup à voir avec le volet littéraire des Angry young men, celui des Sillitoe, Waterhouse ou Wain. Et puis, les Stones eux-mêmes se sont souvenus de Boulgakov pour « Sympathy For The Devil », comme les Beatles citaient Edgar Allan Poe.
On a parlé de ce que le Velvet Underground devait à Selby, ou de ce que Steppenwolf devait à Hesse. Les écrivains américains ont souvent eu partie liée avec le rock le plus subversif et on pourrait citer Ken Kesey, Norman Mailer ou encore Brett Easton Ellis en guise d’illustration.
On oublie pas la littérature fantastique et la science-fiction, bien sûr, à travers des groupes anglais originaux (Hawkwind, Tyrannosaurus Rex, les Pretty Things) mais aussi américains avec le Blue Öyster Cult et tous les groupes de Heavy metal qui s’en sont suivis.
Pour la bande dessinée, les plus grands dessinateurs ont toujours eu à cœur de mettre leur crayon au service du rock et il n’est qu’à regarder certaines pochettes de disque pour s’en convaincre : Crumb avec Janis Joplin ou Ed Cobb avec l’Airplane, sans parler des Blues Magoos, ce groupe de Chicago obsédé par l’univers de la B.D.
Rolling Stone, avant tout le monde (soit avant Esquire, Playboy, Vanity fair et beaucoup d’autres) a inauguré le journalisme Gonzo, soit autant d’articles hallucinés où le narrateur a autant, sinon plus, d’importance que la chose racontée. On connaît Hunter S. Thomson, Harlan Ellison ou Tom Wolfe, tous ces auteurs qui ont aussi influencé un rock narcissique, nerveux et jouissif, autant dire le Punk-rock et ses dérivés new-wave.
Enfin, on parlera aussi du roman policier, pas l’américain et ses privés solitaires, véritables chevaliers des temps modernes, mais de l’anglais, celui des David Peace, Jake Arnott, Ian Rankin, Peter May et autres Robin Cook, soit tous ces auteurs qui ont mis du rock dans leurs pages et dont certains groupes et chanteurs (d’Elvis Costello aux Smiths de Morrisey) ont subi l’inspiration, aussi bien dans les légendes urbaines comme les tueurs des Moors que dans l’atmosphère malsaine de l’East London.
Voilà, les présentations faites, ce qui n’est qu’un découpage par chapitres aura, espérons-le, pu vous laisser deviner ce que sera ce livre ; un livre qu’il reste à écrire et où il ne sera pas inutile de relire des rayons de bibliothèque et de les surligner. Il s’agira en fait bien plus de lire (et de relire) que d’écrire avec, en plus de l’ambition de faire percoler les deux univers, celui, bien plus difficultueux, de mettre les livres en musique et les disques en mots.
Peut-être entendra-t-on des guitares électriques en lisant et, en écoutant, fera-t-on défiler des textes, dans une parfaite osmose entre les mots, les sons et les images ; dans un dérèglement total de tous les sens, comme disait Rimbaud, la première rock star. Et si Dylan était le dernier poète ?
17 septembre 2023
Merci Didier, pour ce rappel magnifique. Quel beau parcours littéraire. Pour ma part, en 1971 quand j’ai passé ma Maîtrise en Études Américaines à la fac de Nanterre, j’ai écrit mon Mémoire sur Jack Kerouac et la Beat Generation, intitulé “Portrait de Jack d’après Desolation Angels”, livre qui n’avait pas encore été traduit en français à l’époque et dont j’avais dû traduire moi-même des extraits pour ce Mémoire.