LA DETTE A PERPÈTE ?
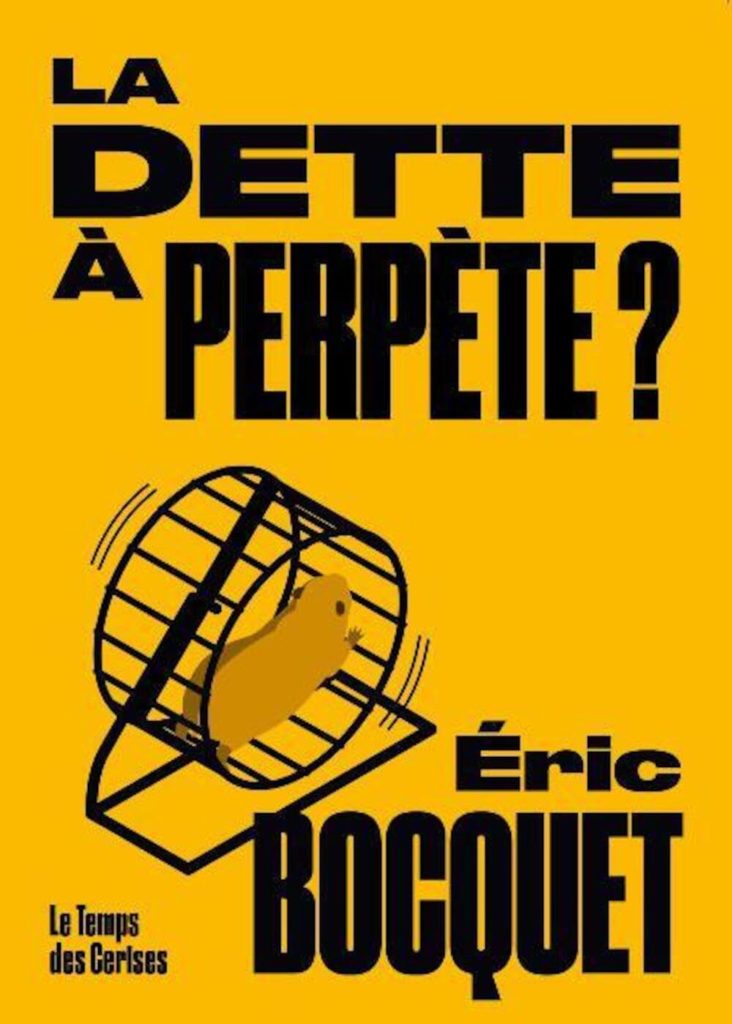
La dette ! La dette ! La dette ! Celle que l’on laisserait à nos enfants et petits-enfants, celle que la bourgeoisie effraie (ou du moins fait-elle semblant de s’effrayer) mais qui condamne pour de vrai le peuple à l’austérité à vie. Il faut savoir que la dette est une construction politique et qu’elle n’est pas naturelle comme la pluie ou le vent. Les gouvernements de tous bords l’ont choisi comme mode de financement dans les années 1970 car elle donne le primat aux marchés et à la finance. Dans son petit livre La dette à perpète, très synthétique et pédagogique – un chef-d’œuvre d’éducation populaire – Éric Bocquet, ex-sénateur communiste et membre d’Attac également expert sur l’évasion fiscale, nous explique tout cela avec clarté.
C’est un petit livre de 90 pages, mais il dit tout, chapitre après chapitre, sur la dette. La dette publique, son origine, l’obligation de se financer sur les marchés financiers, la nécessité d’emprunter, la différence entre dette d’État et dette d’un ménage, la façon dont les États gèrent leur dette, comment celle-ci s’est constituée au fil du temps, comment pèsera-t-elle sur les générations futures, existe-t-il un niveau maximum de dette, peut-on l’annuler et à quelles conditions… Le livre reprend les cas spécifiques de plusieurs pays : les États-Unis avec un endettement record (c’est aussi l’État qui fait la loi en matière de finance), le Japon qui s’est constitué une dette purement nationale avec l’épargne des citoyens japonais, l’Allemagne qui s’est vu annuler l’intégralité de sa dette en 1953 sur fond de guerre froide, car il fallait bien renforcer un allié indéfectible du camp occidental. Il n’en a pas été de même avec la Grèce qui, dans les années 2015 et 2015, s’est vue sévèrement sanctionnée par le gouvernement Merkel – Schaübe après une victoire de la gauche et des menaces d’annulation de la dette. Selon que vous soyez puissant ou misérable disait déjà La Fontaine (pas Oskar, l’autre).
Ce petit livre traite aussi des solutions. Pas les solutions libérales que tout le monde connaît avec les cures d’austérité et le chantage à la dette, mais des pistes pour sortir de cet engrenage mortifère, cette machine à botter le cul, comme on pourrait dire vulgairement. En d’autres termes, peut-on s’affranchir de la tutelle des marchés financiers ? Et, accessoirement mais c’est capital, quel rôle nouveau imaginer pour la BCE qui ne peut pas prêter directement aux États comme en dispose le traité de Maastricht.
Bocquet n’oublie pas de pointer, en fin connaisseur de l’évasion fiscale, de l’intérêt des financiers à prêter à des taux négatifs et des énormes profits que font les banques, les fonds et les institutions financières, se payant sur la bête, ou sur la dette. C’est un marché. Il n’oublie pas non plus les agences de notation, acteurs essentiels du système et qui sont en plein conflit d’intérêt car le notateur est souvent payé indirectement et en partie par l’institution qu’elle est chargée d’auditer.
Pour un État libéré de la dette. Les pistes ne sont pas très nombreuses, mais Bocquet les évoque et c’est peut-être la partie la moins convaincante de son livre. Faut-il revenir au circuit du trésor (banque de France, banques partenaires, bons du trésor) ou ne consentir à la dette que par l’épargne nationale ?
Lapalisse aurait dit que, pour ne pas s’endetter, il faut d’abord ne pas se priver de recettes et c’est ce que les États font depuis trop longtemps, depuis en fait un certain Ronald Reagan qui affirmait que l’État n’était pas la solution, mais le problème. On voit où cela nous a menés.
Taxer les hauts patrimoines, les dividendes, les profits et changer les statuts de la BCE qui deviendrait une institution pouvant prêter directement aux États avec crédit sélectif à faible taux pour la transition écologique et la justice sociale.
« Un cercle vertueux », nous dit-il, mais rien de tout cela ne serait possible sans une victoire de la gauche (c’est moi qui le dit mais il le pense tellement fort).
Un peu d’histoire. La France n’a jamais fait défaut depuis 1797, sans toutefois reconnaître les dettes laissées par l’ancien régime. Tous les budgets de la France ont été à l’équilibre depuis 1974. C’est en 1975 que l’État accuse un budget en déficit.
Il convient à ce stade de rappeler deux mesures funestes pour les futures politiques économiques : la désindexation du dollar et de l’or décidée par Nixon en août 1971 et, plus près de nous, la décision de Giscard, validée par Pompidou, de se financer sur les marchés, en 1973. C’était le vœu des capitalistes et des financiers internationaux car l’État – c’est bien connu – est dépensier et les gouvernements – ça l’est tout autant – ne pensent qu’à se faire réélire. Un peu de rigueur que diable !
On entend par dette à la fois celle de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, ce qui est un non-sens pour ce qui les concerne car elles se doivent de présenter un budget à l’équilibre sous peine de sanctions. L’État, lui, « roule sa dette », se contentant de payer les intérêts.
Quelques chiffres : 134 milliards d’Euros de déficit budgétaire en 2024 plus le remboursement des intérêts, 306 milliards l’an prochain. 72 milliards d’intérêts. Il y aura donc 55 milliards d’économies à réaliser cette année et on sait maintenant comment le gouvernement Barnier entend procéder.
Il faut savoir que la dette est un marché qui fait le bonheur des financiers, prenant le pouvoir aussi bien économique que politique. Au départ, le financement sur les marchés était aussi institué pour éviter l’inflation et donc l’érosion de la rente, mais ce mode de financement a généré toute une industrie et les banques, les fonds et les institutions financières ont tout intérêt (sans jeu de mot) à posséder des dettes d’état dans leurs comptes, ce qu’on appelle des titres de dette souveraine. Les opérations se font par le biais de l’agence France trésor, la bien nommée.
Comment en est-on arrivés là ? Les années 1980, on y revient toujours, où le rapport de force entre travail et capital s’est inversé au niveau mondial, puis la chute du mur et les mécanismes financiers mis en place au niveau européen avec le traité de Maastricht et la création de la BCE à qui il est interdit de prêter aux états.
En Afrique et en Amérique latine, les pays ont dû passer par les fourches caudines du FMI et un rapport du CCFD / Terre solidaire rapporte que, pour un Euro versé, sept vont dans la poche des banques et des institutions financière.
Les résistances ont existé avec Attac ou le CADTM qui a conseillé des pays d’Amérique latine, notamment la Bolivie et l’Équateur, obligeant le FMI à prendre des gants. Le CADTM avait également conseillé au gouvernement Tsipras de classer sa dette en « dette illégitime ou odieuse » car le pays avait été conduit à la banqueroute par des cadres de Goldman-Sachs. Tsipras n’avait pas suivi le conseil et Varoufakis s’en était désolidarisé. On connaît la suite.
On a néanmoins connu des périodes où la finance a dû, contre son gré, rendre gorge. Ce fut le cas notamment en 2008 lorsque Mario Draghi avait décidé les règles de l’assouplissement quantitatif, doux euphémisme signifiant que la BCE pouvait quand même, à titre exceptionnel, prêter directement aux États. Même chose avec le « quoi qu’il en coûte » macronien au temps du Covid, en 2020. On a vu déferler l’argent magique, cet argent hélicoptère dont il avait nié l’existence quelques mois auparavant en s’exprimant avec sa morgue habituelle devant une infirmière qui lui exposait ses difficultés.
Alors, la BCE prêteur en dernier recours aux états avec des taux d’intérêt nuls ou très faibles pour la transition écologique et la justice sociale ? Ce qui s’appelle en d’autres termes la sélectivité du crédit. C’est encore une utopie car la finance n’est pas prête à lâcher le morceau.
En revenir au bon vieux circuit du trésor, soit le financement direct via une banque nationale et les bons du trésor ? Peu probable car cela nécessiterait une refonte totale des systèmes monétaires et il y faudrait un rapport de force autrement important que ce que l’on constate aujourd’hui.
Alors, l’épargne nationale, fausse bonne idée ? Pas sûr, si on tient compte du fait qu’elle s’élève à 6111 milliards d’Euros en France, deux fois la valeur de la dette et qu’on pourrait transformer cette épargne en bons du trésor ou en emprunts d’état.
Solutions de facilité, diraient les libéraux, retour à l’étatisme, au marxisme. Ne faut-il pas s’ouvrir aux vents du large ? Le mur de Berlin n’est-il pas tombé ? Si, mais il nous est tombé sur la gueule. En attendant de renverser la table, ce sera l’austérité à vie et pour l’éternité qui, comme chacun sait, est longue, surtout vers la fin.
LA DETTE À PERPÈTE – ÉRIC BOCQUET – Le temps des cerises – 16€
25 octobre 2024
LE sujet d’actualité ! On nous en rebat les oreilles et surtout pour nous faire peur et nous inciter à voter « comme il faut ». Un sujet « à botter le cul », certes !! L’épargne nationale est-elle la solution ? La suite à la fin de l’éternité…
Merci pour ton commentaire. J’espère que tu vas bien.
Effectivement, la dette est la grosse escroquerie du siècle.
Amitiés