MONSTRES
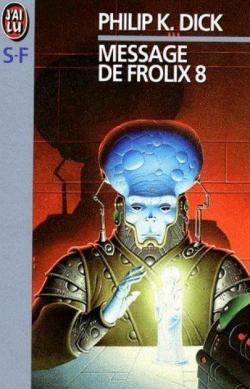
Ils étaient tous difformes et contrefaits. De gentils monstres qui se rappelaient à ma mémoire surgis nus des limbes de mes rêveries. Ils semblaient peiner à inscrire leurs corps disgracieux dans l’espace, comme autant d’insectes lourds engoncés dans leur carapace. Ils n’appelaient personne, ne parlaient pas, ne proféraient aucun son, comme autant de statues de glaise rivés au sol et bien plantés sur leurs membres massifs.
L’un d’eux me jetait des regards implorants que je faisais mine de ne pas percevoir. Tout rapport humain avec eux était proscrit et ils n’appelaient même pas ces assauts de tendresse que l’on pouvait parfois ressentir pour une bête ; n’importe quelle créature qui partageait le même espace et le même temps.
Ils se tenaient à bonne distance et je n’avais a priori rien à craindre d’eux, ces masses indistinctes de chair sombre arrachés à la nuit par quelque sortilège. Des êtres de pierre et d’argile, marmoréens, irréels et indifférents à tout. Je voulais partir et m’éloigner d’eux, mais mes membres ne répondaient pas aux souhaits de ma conscience et j’étais condamné à rester dans leur voisinage, comme si j’avais été l’un d’eux. Disgracié et prostré, comme ils l’étaient tous.
J’entendis l’un d’eux murmurer et, tourné vers moi, il me demandait de l’eau. Il voulait boire et mimait de façon grotesque le geste de s’abreuver, les deux mains réunies formant une manière de récipient qu’il portait à sa bouche lippue dans des gestes répétés de métronome. Je ne pouvais faire semblant une nouvelle fois de l’ignorer, tant son regard avait quelque chose d’implorant et formait contraste avec l’aspect bestial et dépourvu de toute humanité de son corps informe.
Il n’y avait là aucune rivière, aucun cours d’eau et j’étais démuni du moindre ustensile qui eût pu faire office de récipient. Je fis un geste d’impuissance dans sa direction et, alors qu’il s’était avancé de quelques pas, il revint en traînant au même niveau que ses congénères dans un alignement sommaire et imparfait que tous étaient loin de respecter.
Ce fut la seule fois où ils avaient semblé détecter ma présence. En tout cas, l’un d’eux l’avait fait et je me sentais soudain découvert, comme offert à leurs regards, enfin dévoilé et faisant partie intégrante de leur espace ; accessible à leur perception.
Qu’avaient-ils d’humain ? Je ne connaissais même pas leurs besoins et ne les imaginais pas chercher leur pitance pour se nourrir. Des mastodontes de glaise qui étaient dans cette vallée de toute éternité et qui se fondaient dans ce paysage désertique de roche et d’obscurité jonché des quelques traces d’une végétation étique. Je n’étais en rien concerné par ce qui paraissait maintenant émaner du plus profond de leur gosier : une plainte discordante comme un feulement assourdi par des siècles d’ennui qui ne les avaient pas affranchi de la souffrance.
Une bête, un chien de l’enfer au dos crénelé et à la gueule immense s’approcha d’eux dans des ondulations compliquées, comme partagée entre sa volonté d’agresser et sa peur d’une riposte collective. L’un d’eux abattit ce que je distinguais comme étant un gourdin sur l’animal qui n’était plus qu’une tache de sang marronnasse dans des débris d’os. J’en inférais que ces êtres en apparence inoffensifs et sans la moindre agressivité pouvaient être dangereux et, en tout cas, n’hésitaient pas à tuer dès lors qu’un danger approchait. Je me le tins pour dit.
Comme pour confirmer mes craintes, celui qui avait frappé l’horrible animal me lança un regard mauvais comme pour me mettre en garde, me prévenir que je subirai le même sort si d’aventure l’envie de m’approcher d’un peu trop près d’eux me serait venue ; chose déjà impensable mais contre laquelle cette démonstration de force me dissuadait tout à fait.
Ils semblaient habitués à ce genre d’agressions d’une faune qui devait avoir tout de monstrueuse dans ces contrées rocheuses, désertiques où de longues nuits chaudes se succédaient, juste entrecoupées quelques heures par des périodes diurnes où un soleil de plomb brûlait des vestiges de végétation et faisait fondre les pierres. Ils n’avaient pas bougé, restés agglutinés dans un petit espace entre l’endroit où j’étais et un précipice de ténèbres dont ils ne semblaient pas avoir conscience.
Combien étaient-ils ? Comment distinguer des individus dans ce qui paraissait être une masse indistincte, protoplasmique, d’une écoeurante similitude et d’une densité oppressante. Ils étaient peut-être cent en un, ou plutôt un corps immense partagé entre des dizaines de formes autonomes en apparence qui revendiquaient une singularité, une individualité contestables.
Je finis par m’endormir et fus réveillé par les lueurs aveuglantes d’un jour nouveau. Je crus un instant qu’ils avaient disparu, mais il n’en était rien et, à peine sorti des approximations de conscience imputables à un réveil pénible, je les vis à nouveau, là, devant moi. Toujours aussi statiques, toujours aussi massifs dans une désespérante uniformité qui me fit éprouver comme un vertige, un sentiment de « déjà vu », d’éternel retour du même.
Comme enhardis par le jour, ils s’approchaient de moi maintenant et j’avais l’impression qu’ils m’invitaient à les suivre. A me joindre à eux plutôt, tant leur immobilité excluait toute possibilité de les suivre. Je fis quelques signes qui étaient censés traduire, sinon mon aversion pour eux, du moins mon peu d’empressement à les rejoindre. Ils ne semblaient pas m’en vouloir et je crus en voir un hausser les épaules dans un geste de dépit. Le Moloch traduisait sa déception de me voir refuser l’occasion qui s’offrait à moi d’entrer dans ce cortège hideux de géants végétatifs condamnés à la mort lente par leur passivité létale.
Mais peut-être étaient-ils déjà morts ? Peut-être que ces masses informes n’étaient que des états solides intermédiaires entre le vivant et le minéral ? Des chairs argileuses et adipeuses qui allaient bientôt disparaître et se fondre dans la roche, comme pour alimenter ces montagnes majestueuses que je percevais maintenant comme des dieux de pierre alanguis régnant sur des contrées inhabitables.
Je passai encore des heures – ou ce que je percevais comme des heures, mais quelle signification cela avait-il pour eux ? – à leur faire face, sentant confusément un besoin, sinon de m’attirer, de pouvoir me compter parmi eux. Je percevais même un besoin d’attention, de sympathie, voire une certaine tendresse. Mon aversion à leur endroit avait d’ailleurs décliné, et j’étais maintenant presque bienveillant envers ces êtres malheureux et emmurés, prisonniers de leur masse intransportable, cloués au sol.
A la nuit tombée, j’étais maintenant tout près d’eux, à quelques mètres, et je crus percevoir comme un encouragement à m’approcher dans le regard presque humain de l’un d’eux qui allait même jusqu’à esquisser des gestes m’invitant à rejoindre le troupeau indistinct de leurs corps flasques et étales.
Je me fis violence et m’approchai, presque heureux de mettre un terme à ce face à face absurde où il n’y avait même pas d’enjeu de territoire. Peut-être, après tout, connaissaient-ils la bonté ou, à tout le moins, la bienveillance. Peut-être aussi qu’il seraient des alliés dans la lutte quotidienne que j’engageais pour ma survie dans ces terres inhospitalières.
J’allais vers eux et ils m’accueillirent avec des grognements et des témoignages maladroits d’une satisfaction manifeste. Ce n’étaient pas à proprement parler des effusions, mais il y avait dans leur attitude quelque chose qui ressortissait de la joie et de la fraternité. Quelque chose de terriblement humain qui me fit presque pleurer.
On eût dit qu’ils m’avaient adopté, intégré dans leur petit espace, assimilé comme un des leurs.
Petit à petit, je me sentis grossir, doubler puis tripler de volume. Ma peau se durcit et mes membres prirent une épaisseur telle qu’ils ne se distinguaient plus du reste de mon corps. Une humidité visqueuse me recouvrit et ma tête enfla pour ne plus devenir qu’une boîte crânienne informe. Je ne voyais plus rien et n’entendais plus rien. J’étais devenu une masse adipeuse comme reliée aux organismes de mes congénères dans un tout gigantesque qui s’étendait à l’infini.
J’étais passé de l’autre côté. J’étais devenu l’un d’eux, une unité de chair visqueuse dans un océan de graisse. Je ne me sentais même pas dépossédé ou orphelin de mon ancienne identité. Non, j’étais l’un d’eux et c’était bon.
Difforme et contrefait.