MÉDIAPRO – DES MÉGALOS POUR MATCHS DE GALA
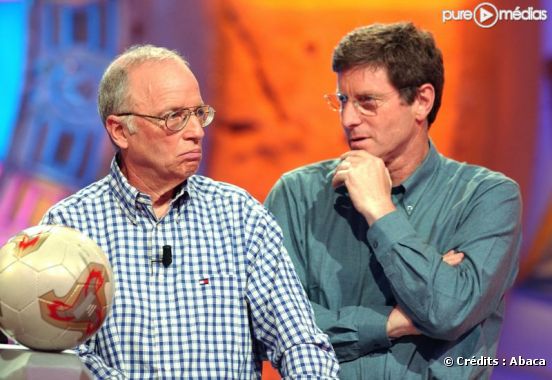
Une chaîne sino-catalane surgie de nulle part – même si elle avait déjà connu une mésaventure en Italie – qui rafle le marché juteux des droits télé du football en France. Après situation de quasi-faillite passée la pandémie, le groupe espagnol se retrouve gros-jean comme devant, incapable d’honorer ses engagements. La Ligue et les clubs en sont fort marris. Un mal pour un bien ?
On le sentait venir, celui-là, le retrait piteux de Téléfoot / Médiapro. Mais l’histoire se situe dans le contexte inflationniste et démesuré des fameux droits télé, en hausse vertigineuse depuis le début des années 80. On est royalement passés de 2 millions d’Euros pour la saison 1984 – 1985 à 748 millions pour la période 2016 – 2020 (L’Humanité du 22 décembre). Mais les records sont faits pour être battus, et on se rappelle que Médiapro avait décroché la timbale pour la modique somme de 800 millions d’Euros rien que pour les droits de retransmission de la Ligue 1. Plus d’un milliard au total, si on compte les 34 millions par an pour la Ligue 2.
La suite est connue. Pour résumer, 123 millions d’Euros seulement versés sur un total dû, pour la seule première année, de 295 millions. Pour le reste, les 172 millions réclamés par la Ligue, qui n’avait soit dit en passant demandé aucune garantie bancaire, ce sera à la Saint-Glinglin. Autant dire jamais, car c’est la banqueroute. Là où Médiapro attendait au moins 3,5 millions d’abonnés, ils sont à peine 300.000 au bout de trois mois d’exercice. C’est Didier Quillot, président de la LFP et ex brillant dirigeant d’Orange et du groupe Lagardère, qui aurait poussé au deal, dans une perspective assumée de foot business quand d’autres avaient crié casse-cou. La ligue est la grande perdante et doit en rabattre, un peu honteuse.
Résultat des courses, une procédure au tribunal de commerce de Nanterre où Médiapro s’engage à verser 100 millions pour l’arrêt des poursuites. On s’en tire à bon compte. 64 ont déjà été royalement payés, reste 36 (10 en mars et le solde en juin 2021, si tout va bien). La ligue, elle, pourra tendre la sébile à l’État, donc au contribuable, pour un prêt de 225 millions (déjà accordé en mai 2020 pour cause de pandémie), à quoi viennent s’ajouter 112 millions prêtés par les banques. Pas de quoi faire oublier la mésaventure.
Lorsque Canal + avait obtenu les droits télé à des tarifs eux aussi exorbitants, les milieux du cinéma (financé en partie par la chaîne) avaient vivement protesté contre ce qui leur apparaissait fort justement comme une dépense inconsidérée dont ils auraient à faire les frais. Bien vu, d’autant que c’est à nouveau Canal qui devrait racheter des droits bradés à 730 millions par saison. Les milieux de la culture doivent encore tousser, surtout dans la période.
Le Canard Enchaîné (23 décembre), nous tire le portrait amusant du fantasque directeur de Médiapro, le catalan Jaume Roures. Un drôle de pistolet, celui-là, « ex sandiniste et trotskyste de toujours (qui) appelait encore récemment de ses vœux la montée d’un grand mouvement social en Espagne ». Ce qui n’empêchait pas ce grand patron de gauche de sous-payer, à la pige et en retard, ses journalistes, sans budget pour leurs frais. Des journalistes ubérisés obligés de choisir le match couvert sur un logiciel maison. Une belle foire d’empoigne. Quant au sort des reporters et consultants, le camarade Roures ne va quand même pas jusqu’à envisager un plan social. Le mouvement social, il pourrait bien l’avoir à sa porte.
Dans une interview à l’Équipe (24 décembre), Jean-Marc Mickeler (président de la DNCG, le gendarme financier du foot) fait le bilan : marché des transferts atones, stades vides, droits télé à revoir à la baisse, soit un déficit d’exploitation de l’ordre de 1 milliard d’Euros pour les clubs professionnels, sans parler des retombées catastrophiques sur le foot amateur. « Ce n’est pas au contribuable français de régler le problème du modèle économique du football », ajoute le sage homme qui préconise des solutions drastiques : encadrement des salaires, baisse des effectifs professionnels, limitation des recrutements… Sous peine de faillites en cascade qui pourraient bien concerner malgré tout certains clubs dépensiers. Il en appelle donc à un nouveau modèle économique et à une résilience à trouver dans la sobriété, sinon l’austérité.
C’en serait fini des années foot et fric des années 80 à nos jours, quand des joueurs pourtant moyens réussissaient à se faire transférer en Angleterre ou en Espagne pour des montants somptuaires, quand des agents de joueurs se faisaient des revenus princiers, quand les présidents de club ne se fixaient plus aucune limite à leurs ambitions. Quand les droits télé étaient exorbitants et quand le cochon de payant de spectateur s’acquittait de tarifs de billetterie de plus en plus élevés. Souhaitons que tout cela change, que les Aulas, Labrune et Al Thani s’effacent et qu’on puisse repartir sur les bases d’un football populaire à hauteur d’homme où un joueur n’était pas forcément un mercenaire et pouvait passer toute sa carrière dans un même club, par amour du maillot (on ne rit pas). Où les entraîneurs ne valsaient pas tous les six mois. Où les présidents de club risquaient leur fortune et pas celle des autres. Rêvons un peu mais, ne serait-ce que pour en finir avec un modèle économique qui va dans le mur, on peut remercier ces escrocs mégalomanes de Médiapro, qui lui auront donné le coup de grâce.
Muchos Gracias, amigos !
23 décembre 2020